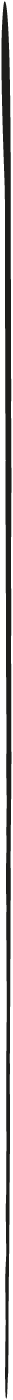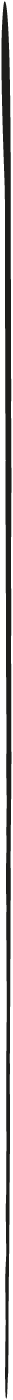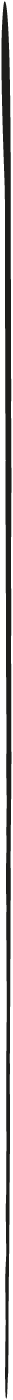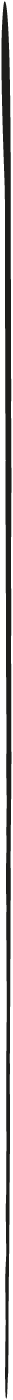
L'Art de Vivre sur la Rupture
– Edito par Mateo Chacón Pino, Teesa Bahana, Margaux Schwab
– Edito par Mateo Chacón Pino, Teesa Bahana, Margaux Schwab
Margaux Schwab (foodculture days) : Il y a exactement trois ans, foodculture days a ouvert un nouveau chapitre éditorial en lançant Boca a Boca. Il était question d’approfondir notre compréhension de certains sujets que nous interrogions et qui nous questionnaient en retour. Chaque rédacteur·ice invité·e apporte ses propres perspectives, réseau et sensibilités en fonction de sa situation, permettant de faire émerger organiquement une perspective transdisciplinaire qui nous tient tant à cœur. L’intention est de s’interroger sur le rôle de l’art et des artistes en soutien à des mouvements sociaux et politiques de changement à différentes échelles et, dans le même temps, de leur fournir une plateforme pour confronter notre regard occidental et ses implications.
Pour cette nouvelle saison éditoriale, au-delà de nourrir la perspective du public sur ce qu’est l’art africain, c’est surtout le sens de ses valeurs et leur expression dans la vie quotidienne qui sont en jeu.

Catherine Lie, Sourdough Architecture (détail), 2024, Festival KLA ART, Avenue Ganzu Lumumba. Photo : Mateo Chacón Pino
Les approches de KLA ART (le festival de 32° East, un centre d’art et de résidence fondé en 2011 à Kampala) et de la Biennale de foodculture days sont similaires en matière d’enquêtes de terrain, de travail culturel et d’organisation plus « lente » de festivals, ainsi que de portée communautaire et des publics touchés. Avec sa directrice Teesa Bahana, nous avons constaté que nous avions un souhait en commun : celui de mieux comprendre les conditions les plus importantes pour permettre des processus artistiques durables à partir du territoire. Nous partagions aussi l’envie de grandir autrement.
Pour sa 5ᵉ édition, le festival KLA ART s’est concentré sur le patrimoine culturel à travers le prisme des gestes et instructions de soin à l’égard du monde vivant. Une réflexion qui fait écho à la vision de foodculture days sur les multiples manières dont un festival peut devenir une plateforme encourageant différentes communautés à explorer des relations plurielles avec leur environnement. Ensemble, nous célébrons la cuisine et l’alimentation comme l’un des rares médiums capables d’exprimer avec autant de justesse des écologies et des territoires complexes. En laissant entrer dans notre corps ce qui est au-dehors, chaque bouchée devient une manifestation de l’interdépendance entre la matière et les affects. Manger nous rend vulnérables.
En envisageant une approche non locale, ce cycle s’interroge sur la manière dont nous pourrions tenter d’atténuer la violence coloniale inhérente aux identités figées et aux soi-disant différences culturelles, en laissant la bouche devenir « un portail, une entrée, une porte », comme l’écrivait déjà Lucy Cordes Engelman dans sa contribution à un cycle précédent de Boca A Boca en 2023.
Une fois encore, nous nous réjouissons de voir comment Boca A Boca est devenu un outil puissant pour rencontrer de nouvelles personnes — par exemple les équipes de 32° EAST et du festival KLA ART — ou approfondir des relations existantes, comme avec Mateo Chacón Pino, et pour nous relier à nos publics à travers une composition infinie de contributions, où chaque entité est l’expression de toutes les autres.
32° East / KLA ART : Les sessions Ekyooto de 32° East tirent leur inspiration du rituel traditionnel des conversations intergénérationnelles au coin du feu, présent dans de nombreuses cultures ougandaises. Elles ont pour objectif de faciliter les discussions bienveillantes et non hiérarchiques entre plusieurs générations et de participer au système alternatif de connaissances vieux de plusieurs générations.

Préparations pour Ekyooto, 2024, Festival KLA ART, champ derrière 32° East. Photo : Mateo Chacón Pino
Notre inauguration Ekyooto a eu lieu lors de KLA ART ‘24, dirigé par l’historien et curateur basé à Kassel, Mateo Chacón Pino. Ces conversations ont exploré l’intersection entre l’art, l’écologie, les soins et la curation au sein de contextes locaux et internationaux. Ce sont les sessions exposant le besoin de plateformes de partage de connaissances alternatives qui ont attiré un plus large public et reçu le plus de retours positifs de la part des personnes présentes et des membres de 32° East. En réponse à ce besoin, nous avons fait d’Ekyooto un évènement récurrent de notre programmation pour 2025, accueillant quatre sessions sur divers sujets, dans l’objectif d’encourager l’échange de connaissances et de compétences, mais aussi des discussions ouvertes sur l’art contemporain et son rôle dans la société.


Ekyooto, 2024, KLA ART Festival, field behind 32° East. Photo: 32° East
Mateo Chacón Pino : Lors de ma préparation pour mon voyage de recherche à Kampala, en Ouganda, j’avais l’intention de chercher des similarités entre les artistes du festival KLA ART et les contributeur·ices de la Biennale de foodculture days. J’avais adopté l’ancien train de pensée européen consistant à associer des choses ou pensées similaires ensemble et séparer ce qui diffère, soit une vision linnéenne sur les espèces ou un repère cartésien. Je ne m’attendais pas à me confronter à une réalité qui différait de mes attentes : l’incarnation de la différence sans séparabilité (pensée développée par la philosophe brésilienne, Denise Ferreira da Silva) à travers la nourriture. Personnellement, j’ai l’habitude d’aller dans des marchés allemands et suisses et de voir une grande variété de pommes, chacune ayant des taille, couleur et goût distincts (sucré, aromatique, frais, acide). Certaines ont même des usages différents en fonction de leur qualité : pour la pâtisserie, en jus, en encas ou même en confiture. Nous en connaissons les saisons et les régions d’origine, la variété et la diversité n’étant pas l’expression de la politique, mais plutôt de culture et d’agriculture. Pourtant, sa voisine à la table de cuisine, la banane, n’a même pas une fraction de cette reconnaissance. Le palais européen ne goûte qu’à la modeste banane Cavendish, la variété dominante internationalement en raison de sa résistance écologique aux maladies infectieuses et de sa monoculture poussée par le profit. La culture est africaine, elle, connaît intimement pléthore de variétés de bananes. Comme l’écrit Rebecca Khamala : vous ne trouverez peut-être pas une banane en Ouganda, mais plutôt des matooke, embidde, bogoya et bien plus encore, toutes avec leurs propres qualités et utilisations. Et souvent, les personnes que je rencontrais me faisaient part de leur variété préférée, des conversations peu différentes de celles avec mes proches suisses autour de nos variétés de pommes favorites. En fait, ces différences montrent plutôt l’impossibilité humaine d’échapper aux dépendances écologiques, malgré la modernité, le capitalisme et, plus important encore, la tentative de remplacer l’écologie par les moyens technologiques.

Brogan Mwesigwa, Kumanyagana (détail), 2024, Festival KLA ART, Avenue Ganzu Lumumba. Photo : Mateo Chacón Pino
Ce que font ces tentatives, en effaçant les différences qui nous rendent humains et nous aliènent de l’humanité de chacune et chacun, est mis en question dans le film de Jim Chuchu. Ce film tente de donner une image pertinente de la famine causée par les humains en Afrique de l’Est, sans tomber dans les pièges de l’exploitation de la pauvreté (« poverty porn ») et de l’exotisme. De façon similaire, cassiane pfund ouvre un débat poétique sur la nécessité de nouvelles images, de nouveaux mots ou sur celle, selon mon interprétation, de la nécessité ou non de s’organiser ensemble rapidement. Les conversations entre Brogan Mwesigwa et Sandra Knecht brisent de multiples clivages à la fois : entre la Suisse et l’Ouganda (le Nord global et le Sud global), entre différentes générations d’artistes et entre des expériences genrées de vie et de travail au sein d’une écologie. Bien que nous ayons en commun le fait que nos vies soient façonnées par les catastrophes climatiques, les différences entre nous et les autres ne reflètent vraiment que nos propres positions sociales, économiques, politiques et écologiques. Pour nous, la souffrance plus ou moins forte d’une personne ne change pas notre expérience et, pourtant, cela pourrait nous guider sur les stratégies potentiellement adaptées à notre situation individuelle.
Le titre de ce cycle est une référence au concept de « rupture métabolique » de Marx, la déconnexion entre la logique capitaliste et les ressources naturelles, ce qui mène aux crises écologiques, telles que la catastrophe climatique actuelle. Peu importe où nous vivons et dans quelles circonstances : personne n’échappera aux conséquences d’une agroéconomie extractive et de monoculture. La survie des humains repose sur la collaboration et l’action plutôt que sur les solutions techniques et les politiques centrées sur l’humain. Et c’est peut-être précisément le sens de l’idée de « vivre sur la rupture » : reconnaître la différence entre être un·e agent·e politique et sujet·te à l’écologie (quel que soit notre lieu de vie) et essayer de prospérer en solidarité. Ces façons de vivre sont réalistes dans le sens qu’elles traitent de la réalité matérielle plutôt que d’articuler les conjectures. Ce n’est pas un exercice de conscience : après tout, le tortionnaire est bien au courant de la douleur de la victime. C’est plutôt une posture morale pour la dimension écologique de toute pratique culturelle, un apprentissage par la différence horizontale.
Mateo Chacón Pino (CO/CH) est un historien de l’art, commissaire d’exposition et auteur. Il a organisé des projets dans des espaces d’art, des musées, des galeries et en milieu agricole en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a participé à The Curatorial and Artistic Thing à sixtyeight art institute à Copenhague ainsi qu’au Curatorial Program de De Appel, à Amsterdam.
Mateo Chacón Pino vit actuellement à Kassel et travaille comme assistant de recherche au documenta Institute et à l’Université de Kassel, au sein du département Art et Société dirigé par la Prof. Dr. Liliana Gómez.
Dans sa thèse de doctorat, The Distinction of Art & Nature, il interroge le temps épistémique de l’histoire de l’art à la lumière de l’Anthropocène et remet en question le concept d’art contemporain dans le contexte de l’exposition. Il a réalisé son mémoire de master en 2021 à l’Université de Zurich sous la direction de la Prof. Dr. Bärbel Küster, portant sur le rôle du financement public de l’art dans la compréhension de l’art, à partir de l’étude de cas du SüdKulturFonds en Suisse. Ses autres axes de recherche incluent les conditions sociales et épistémologiques de l’art, l’histoire du savoir et la philosophie de l’histoire de l’art, ainsi que les questions esthétiques et de durabilité. Son travail est motivé par la question du rôle de l’art dans la transformation vers une société durable.
Avec Friederike Schäfer, il est co-initiateur du groupe de recherche Exhibition Ecologies et membre du réseau Creative Climate Leadership Switzerland, dirigé par Julie’s Bicycle.
Teesa Bahana est la directrice du 32° East, une organisation à but non lucratif qui encourage la création et l'exploration de l'art contemporain en Ouganda. En tant que directrice, elle a soutenu le développement et l'exécution de projets tels que KLA ART Labs pour la recherche et la pensée critique à travers la pratique publique, la troisième édition de KLA ART, le festival d'art public de Kampala, et les échanges de résidences avec des partenaires tels que Arts Collaboratory et Triangle Network. Elle supervise également le projet d'investissement de 32° East, qui vise à collecter des fonds pour construire le premier centre d'art à Kampala. Avec une formation universitaire en sociologie et en anthropologie, elle s'intéresse particulièrement à l'intersection entre l'art et la société ougandaise, et à la manière dont les environnements artistiques devraient être préservés et nourris.
Avant d'être directrice de 32° Est, elle a fait partie du comité d'organisation inaugural du festival international de musique Nyege Nyege et a travaillé dans le domaine de la communication et des relations extérieures pour des organisations éducatives à but non lucratif au Rwanda, au Burundi et en Afrique du Sud. Elle a passé l’année dernière en congé d’études pour préparer un master en Anthropology of Global Futures and Sustainability à la SOAS, Université de Londres.
Margaux Schwab (MX/CH) vit et travaille à Vevey après avoir vécu dix ans à Berlin. Elle est productrice culturelle, chercheuse et commissaire d’exposition travaillant avec les écologies et politiques du vivant à travers l’alimentation et ses imaginaires.
En 2015, elle fonde foodculture days à Vevey, en Suisse, une plateforme de partage de savoirs et de pratiques qui accueille des projets de recherche, de transmission et éditoriaux en ligne. Le fruit de ces moments d'échanges continus est la Biennale foodculture days ayant lieu chaque deux ans gratuitement dans l’espace public veveysan. Valorisant cuisines, marchés, champs, vergers et jardins comme des espaces puissants de transmission de savoir(-faire), Schwab s’intéresse à la place de l’art(iste) dans la transformation des systèmes alimentaires et la manière dont ils peuvent nous relier à nos territoires alimentaires de façon sensible, sensorielle et engagée.
Depuis 2025, elle est professeure invitée à la Haute École d’Art et de Design de Bâle, en Suisse, dans le cadre du programme Co-Create.
L'Art de Vivre sur la Rupture
– Edito par Mateo Chacón Pino, Teesa Bahana, Margaux Schwab
– Edito par Mateo Chacón Pino, Teesa Bahana, Margaux Schwab
Margaux Schwab (foodculture days) : Il y a exactement trois ans, foodculture days a ouvert un nouveau chapitre éditorial en lançant Boca a Boca. Il était question d’approfondir notre compréhension de certains sujets que nous interrogions et qui nous questionnaient en retour. Chaque rédacteur·ice invité·e apporte ses propres perspectives, réseau et sensibilités en fonction de sa situation, permettant de faire émerger organiquement une perspective transdisciplinaire qui nous tient tant à cœur. L’intention est de s’interroger sur le rôle de l’art et des artistes en soutien à des mouvements sociaux et politiques de changement à différentes échelles et, dans le même temps, de leur fournir une plateforme pour confronter notre regard occidental et ses implications.
Pour cette nouvelle saison éditoriale, au-delà de nourrir la perspective du public sur ce qu’est l’art africain, c’est surtout le sens de ses valeurs et leur expression dans la vie quotidienne qui sont en jeu.

Catherine Lie, Sourdough Architecture (détail), 2024, Festival KLA ART, Avenue Ganzu Lumumba. Photo : Mateo Chacón Pino
Les approches de KLA ART (le festival de 32° East, un centre d’art et de résidence fondé en 2011 à Kampala) et de la Biennale de foodculture days sont similaires en matière d’enquêtes de terrain, de travail culturel et d’organisation plus « lente » de festivals, ainsi que de portée communautaire et des publics touchés. Avec sa directrice Teesa Bahana, nous avons constaté que nous avions un souhait en commun : celui de mieux comprendre les conditions les plus importantes pour permettre des processus artistiques durables à partir du territoire. Nous partagions aussi l’envie de grandir autrement.
Pour sa 5ᵉ édition, le festival KLA ART s’est concentré sur le patrimoine culturel à travers le prisme des gestes et instructions de soin à l’égard du monde vivant. Une réflexion qui fait écho à la vision de foodculture days sur les multiples manières dont un festival peut devenir une plateforme encourageant différentes communautés à explorer des relations plurielles avec leur environnement. Ensemble, nous célébrons la cuisine et l’alimentation comme l’un des rares médiums capables d’exprimer avec autant de justesse des écologies et des territoires complexes. En laissant entrer dans notre corps ce qui est au-dehors, chaque bouchée devient une manifestation de l’interdépendance entre la matière et les affects. Manger nous rend vulnérables.
En envisageant une approche non locale, ce cycle s’interroge sur la manière dont nous pourrions tenter d’atténuer la violence coloniale inhérente aux identités figées et aux soi-disant différences culturelles, en laissant la bouche devenir « un portail, une entrée, une porte », comme l’écrivait déjà Lucy Cordes Engelman dans sa contribution à un cycle précédent de Boca A Boca en 2023.
Une fois encore, nous nous réjouissons de voir comment Boca A Boca est devenu un outil puissant pour rencontrer de nouvelles personnes — par exemple les équipes de 32° EAST et du festival KLA ART — ou approfondir des relations existantes, comme avec Mateo Chacón Pino, et pour nous relier à nos publics à travers une composition infinie de contributions, où chaque entité est l’expression de toutes les autres.
32° East / KLA ART : Les sessions Ekyooto de 32° East tirent leur inspiration du rituel traditionnel des conversations intergénérationnelles au coin du feu, présent dans de nombreuses cultures ougandaises. Elles ont pour objectif de faciliter les discussions bienveillantes et non hiérarchiques entre plusieurs générations et de participer au système alternatif de connaissances vieux de plusieurs générations.

Préparations pour Ekyooto, 2024, Festival KLA ART, champ derrière 32° East. Photo : Mateo Chacón Pino
Notre inauguration Ekyooto a eu lieu lors de KLA ART ‘24, dirigé par l’historien et curateur basé à Kassel, Mateo Chacón Pino. Ces conversations ont exploré l’intersection entre l’art, l’écologie, les soins et la curation au sein de contextes locaux et internationaux. Ce sont les sessions exposant le besoin de plateformes de partage de connaissances alternatives qui ont attiré un plus large public et reçu le plus de retours positifs de la part des personnes présentes et des membres de 32° East. En réponse à ce besoin, nous avons fait d’Ekyooto un évènement récurrent de notre programmation pour 2025, accueillant quatre sessions sur divers sujets, dans l’objectif d’encourager l’échange de connaissances et de compétences, mais aussi des discussions ouvertes sur l’art contemporain et son rôle dans la société.


Ekyooto, 2024, KLA ART Festival, field behind 32° East. Photo: 32° East
Mateo Chacón Pino : Lors de ma préparation pour mon voyage de recherche à Kampala, en Ouganda, j’avais l’intention de chercher des similarités entre les artistes du festival KLA ART et les contributeur·ices de la Biennale de foodculture days. J’avais adopté l’ancien train de pensée européen consistant à associer des choses ou pensées similaires ensemble et séparer ce qui diffère, soit une vision linnéenne sur les espèces ou un repère cartésien. Je ne m’attendais pas à me confronter à une réalité qui différait de mes attentes : l’incarnation de la différence sans séparabilité (pensée développée par la philosophe brésilienne, Denise Ferreira da Silva) à travers la nourriture. Personnellement, j’ai l’habitude d’aller dans des marchés allemands et suisses et de voir une grande variété de pommes, chacune ayant des taille, couleur et goût distincts (sucré, aromatique, frais, acide). Certaines ont même des usages différents en fonction de leur qualité : pour la pâtisserie, en jus, en encas ou même en confiture. Nous en connaissons les saisons et les régions d’origine, la variété et la diversité n’étant pas l’expression de la politique, mais plutôt de culture et d’agriculture. Pourtant, sa voisine à la table de cuisine, la banane, n’a même pas une fraction de cette reconnaissance. Le palais européen ne goûte qu’à la modeste banane Cavendish, la variété dominante internationalement en raison de sa résistance écologique aux maladies infectieuses et de sa monoculture poussée par le profit. La culture est africaine, elle, connaît intimement pléthore de variétés de bananes. Comme l’écrit Rebecca Khamala : vous ne trouverez peut-être pas une banane en Ouganda, mais plutôt des matooke, embidde, bogoya et bien plus encore, toutes avec leurs propres qualités et utilisations. Et souvent, les personnes que je rencontrais me faisaient part de leur variété préférée, des conversations peu différentes de celles avec mes proches suisses autour de nos variétés de pommes favorites. En fait, ces différences montrent plutôt l’impossibilité humaine d’échapper aux dépendances écologiques, malgré la modernité, le capitalisme et, plus important encore, la tentative de remplacer l’écologie par les moyens technologiques.

Brogan Mwesigwa, Kumanyagana (détail), 2024, Festival KLA ART, Avenue Ganzu Lumumba. Photo : Mateo Chacón Pino
Ce que font ces tentatives, en effaçant les différences qui nous rendent humains et nous aliènent de l’humanité de chacune et chacun, est mis en question dans le film de Jim Chuchu. Ce film tente de donner une image pertinente de la famine causée par les humains en Afrique de l’Est, sans tomber dans les pièges de l’exploitation de la pauvreté (« poverty porn ») et de l’exotisme. De façon similaire, cassiane pfund ouvre un débat poétique sur la nécessité de nouvelles images, de nouveaux mots ou sur celle, selon mon interprétation, de la nécessité ou non de s’organiser ensemble rapidement. Les conversations entre Brogan Mwesigwa et Sandra Knecht brisent de multiples clivages à la fois : entre la Suisse et l’Ouganda (le Nord global et le Sud global), entre différentes générations d’artistes et entre des expériences genrées de vie et de travail au sein d’une écologie. Bien que nous ayons en commun le fait que nos vies soient façonnées par les catastrophes climatiques, les différences entre nous et les autres ne reflètent vraiment que nos propres positions sociales, économiques, politiques et écologiques. Pour nous, la souffrance plus ou moins forte d’une personne ne change pas notre expérience et, pourtant, cela pourrait nous guider sur les stratégies potentiellement adaptées à notre situation individuelle.
Le titre de ce cycle est une référence au concept de « rupture métabolique » de Marx, la déconnexion entre la logique capitaliste et les ressources naturelles, ce qui mène aux crises écologiques, telles que la catastrophe climatique actuelle. Peu importe où nous vivons et dans quelles circonstances : personne n’échappera aux conséquences d’une agroéconomie extractive et de monoculture. La survie des humains repose sur la collaboration et l’action plutôt que sur les solutions techniques et les politiques centrées sur l’humain. Et c’est peut-être précisément le sens de l’idée de « vivre sur la rupture » : reconnaître la différence entre être un·e agent·e politique et sujet·te à l’écologie (quel que soit notre lieu de vie) et essayer de prospérer en solidarité. Ces façons de vivre sont réalistes dans le sens qu’elles traitent de la réalité matérielle plutôt que d’articuler les conjectures. Ce n’est pas un exercice de conscience : après tout, le tortionnaire est bien au courant de la douleur de la victime. C’est plutôt une posture morale pour la dimension écologique de toute pratique culturelle, un apprentissage par la différence horizontale.
Mateo Chacón Pino (CO/CH) est un historien de l’art, commissaire d’exposition et auteur. Il a organisé des projets dans des espaces d’art, des musées, des galeries et en milieu agricole en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. Il a participé à The Curatorial and Artistic Thing à sixtyeight art institute à Copenhague ainsi qu’au Curatorial Program de De Appel, à Amsterdam.
Mateo Chacón Pino vit actuellement à Kassel et travaille comme assistant de recherche au documenta Institute et à l’Université de Kassel, au sein du département Art et Société dirigé par la Prof. Dr. Liliana Gómez.
Dans sa thèse de doctorat, The Distinction of Art & Nature, il interroge le temps épistémique de l’histoire de l’art à la lumière de l’Anthropocène et remet en question le concept d’art contemporain dans le contexte de l’exposition. Il a réalisé son mémoire de master en 2021 à l’Université de Zurich sous la direction de la Prof. Dr. Bärbel Küster, portant sur le rôle du financement public de l’art dans la compréhension de l’art, à partir de l’étude de cas du SüdKulturFonds en Suisse. Ses autres axes de recherche incluent les conditions sociales et épistémologiques de l’art, l’histoire du savoir et la philosophie de l’histoire de l’art, ainsi que les questions esthétiques et de durabilité. Son travail est motivé par la question du rôle de l’art dans la transformation vers une société durable.
Avec Friederike Schäfer, il est co-initiateur du groupe de recherche Exhibition Ecologies et membre du réseau Creative Climate Leadership Switzerland, dirigé par Julie’s Bicycle.
Teesa Bahana est la directrice du 32° East, une organisation à but non lucratif qui encourage la création et l'exploration de l'art contemporain en Ouganda. En tant que directrice, elle a soutenu le développement et l'exécution de projets tels que KLA ART Labs pour la recherche et la pensée critique à travers la pratique publique, la troisième édition de KLA ART, le festival d'art public de Kampala, et les échanges de résidences avec des partenaires tels que Arts Collaboratory et Triangle Network. Elle supervise également le projet d'investissement de 32° East, qui vise à collecter des fonds pour construire le premier centre d'art à Kampala. Avec une formation universitaire en sociologie et en anthropologie, elle s'intéresse particulièrement à l'intersection entre l'art et la société ougandaise, et à la manière dont les environnements artistiques devraient être préservés et nourris.
Avant d'être directrice de 32° Est, elle a fait partie du comité d'organisation inaugural du festival international de musique Nyege Nyege et a travaillé dans le domaine de la communication et des relations extérieures pour des organisations éducatives à but non lucratif au Rwanda, au Burundi et en Afrique du Sud. Elle a passé l’année dernière en congé d’études pour préparer un master en Anthropology of Global Futures and Sustainability à la SOAS, Université de Londres.
Margaux Schwab (MX/CH) vit et travaille à Vevey après avoir vécu dix ans à Berlin. Elle est productrice culturelle, chercheuse et commissaire d’exposition travaillant avec les écologies et politiques du vivant à travers l’alimentation et ses imaginaires.
En 2015, elle fonde foodculture days à Vevey, en Suisse, une plateforme de partage de savoirs et de pratiques qui accueille des projets de recherche, de transmission et éditoriaux en ligne. Le fruit de ces moments d'échanges continus est la Biennale foodculture days ayant lieu chaque deux ans gratuitement dans l’espace public veveysan. Valorisant cuisines, marchés, champs, vergers et jardins comme des espaces puissants de transmission de savoir(-faire), Schwab s’intéresse à la place de l’art(iste) dans la transformation des systèmes alimentaires et la manière dont ils peuvent nous relier à nos territoires alimentaires de façon sensible, sensorielle et engagée.
Depuis 2025, elle est professeure invitée à la Haute École d’Art et de Design de Bâle, en Suisse, dans le cadre du programme Co-Create.


QUELS RITUELS POUR LE FUTURE, QUELS RITUELS POUR LE PRÉSENT ? à propos de commémoration et d’incertitude – par Cassiane Pfund
au début
je souhaitais imaginer des rituels pour le futur
pour combler un vide
embrasser la confiance
et convoquer l’espoir
célébrer
et faire communauté
une vérité désagréable est que je ne sais plus
je ne sais plus ni où débuter
ni de quelle manière poursuivre ou m’arrêter
je ne sais pas
et ne pas savoir actuellement n’a jamais été aussi difficile
mais ai-je vraiment déjà su ?
et toi, as-tu vraiment déjà su ?
depuis la suisse, j’observe qu’un certain nombre de travaux
récents et d’expositions, de textes, de programmes de
recherche et d’appels à projets decident de
démêler, déplier, étendre, pirater, recréer, construire, défaire,
remodeler, réinventer et concevoir des futurs.
mais qu’est-ce que serait
comment sonnerait ou goûterait
un futur auquel aspirer ?
00. quelle(s) langue(s) ?
l’art de raconter des histoires ainsi que les récits souterrains ont
probablement été une manière de résister aux oppressions et
aux incertitudes, un geste permettant d’imaginer des solutions
alternatives et de se rassembler depuis que les êtres humains
ont développé le langage.
lorsque j’ai reçu l’invitation de mateo chacón pino pour l’écriture
d’un texte, ma bouche me sembla soudain asséchée comme si
ma langue avait disparu, et les mots, à peine présents une
question est alors survenue :
a-t-on besoin d’encore et encore et encore et encore plus de mots ?
dans une tentative de saisir quelque chose d’un paysage
dont mes doigts ne reconnaissent pas la plupart des textures
de futurs qui apparaissent flous
–inimaginables et distants, pourtant si proches–
je m’assieds au bord de la rivière
à la recherche de sédiments et de cailloux
pour une nouvelle langue
une langue sensible
pour ce qui est
ce qui résiste
ce qui évolue
ce qui survit
une langue qui danse
une langue qui doute et fait confiance
une langue qui écoute
une langue pour le présent
pause
la gravité est ce qui a la capacité de faire couler les corps, tout
autant qu’elle leur permet d’être soutenus, aussi longtemps
qu’un sol demeure.
– dans tous les cas
nous apprendrons à respirer
nous apprendrons à nager
iels disent
qui est nous ?
qui est iels ?
pause
à présent
ferme les yeux
ta propre peau
fondue avec la mer
se ressent comme celle translucide d’une méduse
des mammifères marines¹ apparaissent
des incendies sous-marins l’instant d’après
et la même mélodie
encore et encore
te rappelle une fondation sacrée
les créatures venues avant
celles qui – espérons-le,– viendront après
01. future(s)
si demain peut être entendu autant comme
le surlendemain
une période proche
dans quelques siècles ou décennies
ou même lorsque le soleil explosera
–et probablement un peu avant–
de quel(s) futur(s) s’agit-il ?
qu’est-ce qui est entendu par le mot «futur» ?
est-ce réellement et uniquement une question temporelle ?
et qu’est-ce qui pourrait rendre possible les futurs
auxquels aspirer ?
j’ai lu quelque part que des recherches actuelles sur la
physique quantique continuent de souligner à quel point notre
compréhension de ce qu’est le futur est lacunaire. aussi
fascinant que cela puisse être, le temps perçu comme linéaire
tendrait à se calquer en réalité sur une représentation
commune de l’existence humaine ; une ligne du temps
chronologique qui débute avec la naissance et se termine avec
la mort.
mais est-ce vraiment le cas ?
dans sa performance niagara 3000, l’artiste pamina de coulon
emprunte la citation suivante à l’auteur paolo cognetti :
le futur vient de l’amont²
pause
à présent
je ferme les yeux
la même mélodie
les créatures venues avant
celles qui viendront après
je les espère
02. où commencer ?
un point de départ pourrait être la causalité, tout en gardant
à l’esprit la complexité et l’incertitude propres à la
multifactorialité, soit lorsque différents facteurs sont impliqués.
par exemple, il est souvent difficile d’isoler un facteur
responsable de migraines car
on attribue le plus souvent ces dernières à un ensemble
d’éléments possibles, tels que l’alimentation, le stress,
certaines stimulations sensorielles, la pollution, les abus, etc.
or, la plupart du temps, lorsque ces facteurs sont
combinés, il est complexe d’identifier ce qui cause quoi,
comment, et avec quelle intensité, bien qu’une approche dite
holistique mette en lumière les notions de système et
d’écosystème.
si une partie de ce qu’un futur auquel aspirer dépend de
comment nous, en tant que sociétés, décidons d’agir, de ce que
nous, en tant que sociétés, décidons d’incarner et de nourrir,
comment le lit d’un tel futur peut il se préparer maintenant ?
comment, tout en embrassant l’inconfort de l’incertitude,
pouvons-nous trouver des passages au travers ?
comment pouvons-nous nous autoriser à faire le deuil, non en
tant que signe d’une impuissance apprise, mais plutôt en tant
que une manière d’intégrer la fragilité de la vie et ainsi
réactiver notre amour pour la planète sur laquelle nous flottons ?
et encore une fois, qui est nous ?
dans son dernier livre³, amandine gay exprime avec clarté la
nécessité d’une transformation initiée par un mouvement
intime. elle écrit :
nous aspirions à transformer la société sans avoir
pris conscience que cela commençait avec notre
propre libération des carcans que sont le
productivisme, la compétition, le besoin d’attention ou même
la précarité.⁴
sa vision offre la possibilité d’un retour à son propre corps situé
tout en décentrant les valeurs promues par la suprématie
blanche. avec lucidité, elle parle du piège de la
perpétuation des oppressions – en internalisant puis en
reproduisant ses outils – non pas avec l’intention de blâmer les
individus, mais avec celle de rappeler qu’une possible
transformation collective débute avec soi-même.
03. un savoir⁵ hiérarchisé, et les corps ?
en 2016, je suis un cours d’introduction à l’épistémologie⁶, et
rate magistralement l’examen théorique. je me souviens de
mes difficultés à rencontrer la matière, à la digérer, sentant
qu’au sein de cette approche quelque chose d’essentiel me
manquait, sans pour autant parvenir à identifier quoi. puis, j’ai
commencé à regarder autour de moi, avant de réaliser que
l’institution – au sein de laquelle j’ai essayé de me fondre non
sans anxiété – avait tendance à se revendiquer temple de la
connaissance, tout en échouant non seulement à rendre
compte d’une diversité de ces mêmes connaissances, mais
également à élargir ses perspectives, représentations et points
de vue.
une année plus tard, je rencontre marie lefebvre – une
chercheuse vivant à montréal que j’ai la joie d’appeler amie –
qui m’introduit à une pratique à la fois sociale et philosophique
dont le but est de décentrer une perception répandue de
l’intelligence dite «cérébrale» et du savoir. une telle pratique
souligne l’écoute comme nécessité – dans un sens large – ainsi
que la considération de toute personne en tant qu’agente
épistémique potentielle puisque l’on peut apprendre de
chacun-e-x. cette vision invite à la constitution d’un espace
destiné à la redistribution du pouvoir qui interroge les
stéréotypes de même que les obstacles à la légitimité.
voici une définition du savoir ttelle qu’identifiée par le centre
national de ressources textuelles et lexicales :
[l’] ensemble des connaissances d'une personne ou
d'une collectivité acquises par l'étude, par
l'observation, par l'apprentissage et/ou par l'expérience.⁷
je me demande comment pourraient coexister sans hiérarchie
différents modes d’acquisition de connaissances, et au-delà de
ces modes, comment tendre collectivement vers ce que
m’expliquait marie.
et que dire de l’accès «au savoir» ?
se pourrait-il que l’absence de corps situés au sein du champ
analytique académique fût un facteur déterminant de
la déconnexion dont j’ai fait l’expérience ?
et si c’est le cas, comment valoriser une intelligence corporelle
afin d’opérer un renversement depuis un lieu qui nous est
commun : nous faisons l’expérience et nous ressentons,
avec la sensibilité et les possibilités qui nous sont propres, donc
nous appartenons ?
cultiver des visions à long terme contribue à offrir une direction
aux actions et à entretenir un sens. pourtant, si imaginer des
futurs se révèle crucial, cela ne peut pas être suffisant en soi,
puisque l’acte d’imaginer s’inscrit dans le présent⁸, et je
préciserais même, au sein de présents situés.
un futur auquel aspirer n’adviendra pas comme par magie
sans prendre ses responsabilités
sans le démantèlement de toute forme de suprématie
sans ressentir
et revenir aux (à nos) corps avec une honnêteté radicale
04. injustice épistémique
la notion d’injustice épistémique, inventée par miranda fricker⁹,
invite à aborder la question du savoir et des connaissances
comme pouvoir. en effet, qui est perçu-e-x comme contribuant à
la production de savoirs, et qui ne l’est pas ? Quelles voix sont
entendues, lesquelles sont ignorées, lesquelles sont réduites
au silence ?
à chaque fois qu’une voix est ignorée ou réduite
au silence, ce qui sera retenu du passé rétrécit, et avec
elle une compréhension du présent. afin de ressentir le(s)
présent(s) en train d’être vécu(s), et d’imaginer différents types
de futurs possibles, il y a une nécessité manifeste d’œuvrer
en faveur de la résistance à la séparation.
à propos de séparation, wendy delorme¹⁰ – parmi de
nombreusex auteuricesx et artistes – réaffirme dans un
entretien mené par constant spina pour le magazine
censored¹¹ :
nous sommes un tout : humains, arbres, montagnes,
cours d’eau et animaux. tout le monde du vivant est
interconnecté, interdépendant. c’est très simple, c’est
une évidence, et pourtant, de par nos modes de vie
d’aujourd’hui, on ne cesse de l’oublier.¹²
un article sur l’injustice épistémique au sein du champ de
recherche de la psychiatrie fournit une compréhension de
ce concept introduit par miranda fricker :
epistemic injustice is a form of systemic discrimination
relating to the creation of knowledge. it occurs when
people from marginalized groups are denied capacity
as ‘epistemic agents’ (i.e., as creators of knowledge),
and are diminished or excluded from the process of
creating meaning. such exclusion creates conditions
in which the lived experiences of marginalized people
are primarily interpreted by people who do not share
their social position. […] as an approach, lived
experience work recognized that marginalized people are
rarely afforded the opportunity to theorize their own
experiences and generate solutions.¹³
l’injustice épistémique est une forme de
discrimination systémique qui a trait à la
production du savoir. elle intervient lorsque
des personnes appartenant à des groupes
marginalisés se voient refuser leur capacité
«d’agent épistémique» (comme créatrices de
savoir) et sont ainsi rabaissées ou exclues
des processus relatifs à sa production. une
telle exclusion produit les conditions dans
lesquelles les expériences vécues des
personnes marginalisées sont avant tout
interprétées par des personnes qui ne
partagent pas la même position sociale. […] en
tant qu’approche, le travail sur l'expérience
vécue reconnaît que les personnes
marginalisées ont rarement l'occasion de
théoriser leurs propres expériences et de
trouver des solutions.
l’article mentionne l’exploitation épistémique et en avertit
du risque, elle semble
être une autre forme d’extractivisme lorsque les expériences
vécues sont absorbées par des structures dominantes
préexistantes au sein desquelles elles deviennent des tokens¹⁴.
en réalité, la question des expériences vécues, lorsque
confrontée à une mécanique extractiviste, est profondément
interconnectée avec celle de la pensée coloniale:
[the question of the lived experiences] has
encountered an inherent problem though in seeking to
challenge western traditional valuing of positivist
approaches to research, with their emphasis on
‘objectivity’, ‘neutrality’ and ‘distance’. these are still strong
in the psych system and have distorted our
understandings of what counts as knowledge. so, if you
have direct experience of a problem, like poverty,
distress or indeed colonisation, where such research
values apply, you can expect to be granted less credibility
and your knowledge seen as less reliable
because you are ‘too close to the problem’ – it affects you
and you cannot claim to be neutral, objective and distant
from it. thus, you can expect to be seen as an inferior
knower and your knowledge less reliable. this
means effectively that if you have experience of
discrimination and oppression you can expect
routinely to face further discrimination and be further
marginalised and devalued.¹⁵
[la question des expériences vécues] a
rencontré un problème inhérent en se
confrontant à une vision occidentale
traditionaliste sur la valeur accordée aux
approches dites «positivistes» dans le
champ de la recherche, soit des approches
qui soutiennent l’«objectivité», la «neutralité»
et la «distance». ces notions, très présentes
dans le système psychiatrique, ont déformé
nos compréhensions de ce qui compte en
tant que «savoir». ainsi, lorsque certaines de
ces valeurs s’appliquent alors même que
vous faites l’expérience directe d’un
problème, tel que la pauvreté, de la détresse
ou la colonisation, vous pouvez
escompter à ce que
d’une part, l’on vous perçoive comme moins
crédible en tant que sachant, et que, d’autre part,
votre savoir ou vos connaissances risquent
d’être perçus comme moins fiables en raison de
votre «trop grande proximité avec le problème» :
car puisque cela vous affecte, vous ne pouvez
revendiquer ni neutralité, ni objectivité, ni
distance. cela implique
en réalité que si vous faites
l’expérience de discrimination et d’oppression,
vous pourriez
faire face à d’autres discriminations et
connaître régulièrement davantage de mépris
et de marginalisation.
05. savoir sensible
le centre d’archivage des savoirs sensibles est une œuvre de la
compagnie création dans la chambre¹⁶ que j’aime beaucoup.
elle met en lien l’archive populaire, le(s) savoir(s) et la mémoire.
en voici une description trouvée sur le site internet de la
compagnie, après adaptation en langage inclusif :
cette installation monumentale d’archivage populaire
offerte aux citoyen-n-e-x-s deviendra en quelque sorte
un lieu d’échange poétique d’apprentissage, sans
discrimination quant à l’autorité d’un savoir sur un
autre; nous voulons proposer un espace déhiérarchisé
où tou-x-t-e-s peuvent laisser quelque chose au monde
dans une optique de transmission. que ce soit par un
enseignement artisanal unique, une chanson cachée
dans un vieux souvenir, l’histoire d’un-e-x aïeul-e-x
transmise par l’oralité, une recette familiale ancestrale
ou l’étude toute personnelle d’un comportement
animalier, chacun pourra agir sur la mémoire collective en
perpétuelle construction.
le centre d’archivage des savoirs sensibles met en lumière une
dimension essentielle : le savoir ne peut être réduit à un seul
type ou à une catégorie. la vigilance et l’humilité sont de mise
afin d’éviter l’écueil d’une hiérarchisation entre une forme et
une autre, tout en ayant conscience d’où les savoirs
proviennent, comment ils circulent et/ou s’ils ont été
appropriés.
06. lignée et commémoration
alors que je me demande quels outils pourraient contribuer à
incarner un changement de perspective, la commémoration me
rend visite.
que restera-t-il lorsqu’il n’y aura plus personne pour se
souvenir ?
il y a plusieurs semaines, en assistant à une partie de la
rencontre organisée par l’afrikalab¹⁷, comodérée par ivan
larson ndengue, avec germaine acogny et shelly ohene-nyako,
la notion de lignée est apparue comme une manière nécessaire
à la fois d’honorer et de rappeler des personnes qui nous
ont appris, et donc, , celles qui nous ont transmis.
la commémoration est un acte d’être ensemble
un moyen de résistance collective
qui empêche l’annihilation de la mémoire
un rituel pour conserver des traces
les ramener à la vie pour un temps
avant de les transmettre plus loin
j’aime le voir comme un cycle honorant ce qui est venu avant
recevoir
écouter
apprendre
interroger
refuser
nourrir
transformer
puis confier
un cycle ayant ses rythmes propres qui requiert
présence et lenteur
conscience et proximité
être dans la conscience de ce qui a rendu possible la vie
nous invite à procéder à une chorégraphie continue
un mouvement qui défie la linéarité
convoquant d’anciens souvenirs
demandant d’ajuster
de choisir ce que nous continuerons d’honorer
ce que nous aurons transformé
– ou tenté de transformer–
d’imprimer les traces que nous laisserons
et répéter
depuis là où j’écris
et pour le moment
cette fondation demeure.
la pratique de cassiane c. pfund (BR/CH) se situe dans les interstices. en réassemblant l’écriture, l’art, la recherche et la poésie, elle considère les mots comme les points de départ d’une exploration d’autres médias, tels que la performance, les installations et la publication en tant que sculptures et expériences collectives de transmission. l’artiste désire ouvrir des espaces au ralenti dans lesquels les gens peuvent se rencontrer, partager des histoires, exprimer leurs émotions et soulever des questions.
cassiane c. pfund (*1993) vit à Genève. l’artiste a d’abord étudié la philosophie (master à l’Unige et l’UQAM, 2018), puis a souhaité éprouver et approfondir des concepts d’un point de vue artistique physique et interdisciplinaire (MasterCap HKB, 2020).
site web : cassianepfund.ch
[1] l’expression « mammifères marines » est empruntée à l’autrice et chercheuse alexis pauline gumps et à son texte non-noyées, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines, traduit de l’anglais par mabeuko oberty, myriam rabah-konaté et rose b, paru aux éditions burn-août et les liens qui libèrent (2024).
[2] niagara 3000 est une performance de l’artiste et autrice pamina de coulon issue de la saga fire of emotions.
[3] gay amandine, vivre libre, exister au coeur de la suprématie blanche, cahiers libres, la découverte, octobre 2025.
[4] ibid., p.114.
[5] en anglais, le terme « knowledge » réfère indistinctement au savoir et à la connaissance, ce qui n’est pas le cas en français.
[6] le cours d’introduction à l’épistémologie est un module obligatoire au sein des études de philosophie à l’université de genève.
[7] cette définition est tirée du CNTRL : https://www.cnrtl.fr/definition/savoir .
[8] lors de son intervention au sein de l’école w.o.r.d., l’autrice et militante sarah durieux a introduit l’importance d’un ancrage du discours dans le présent à propos du storytelling et du discours politique.
[9] l’histoire retient que la notion d’injustice épidémique est formulée pour la première fois par la philosophe miranda fricker.
[10] wendy delorme est une autrice performeuse, enseignante, chercheuse et militante féministe française.
[11] censored magazine est une plateforme éditoriale où se croisent idées féministes, création émergente et transmission, au-delà des récits dominants.
[12] ibid., constant spina (2025), entretien avec wendy delorme : le roman comme un cycle de l’eau, [en ligne].
[13] celestin okoroji, tanya mackay, dan robotham, dation beckford, vanessa pinfold (2023), epistemic injustice and mental health research: e pragmatic approach to working with lived experience expertise, frontiers in psychiatry, vol. 14, [en ligne], https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2023.1114725/full
[14] le tokénisme désigne la pratique à laquelle un groupe, ou un organisme, a recours, afin d'inclure des personnes issues des minorités, sans pour autant que de réels changements structurels soient opérés ou que ces personnes soient soutenues sur le long cours, car il est en réalité question d’une inclusion de façade.
[15] peter beresford, diana rose (2023), decolonising global mental health: the role of mad studies, cambridge prisms: global mental health, cambridge university press, [en ligne], https://www.cambridge.org/core/journals/global-mental-health/article/decolonising-global-mental-health-the-role-of-mad-studies/EEF259FE948CAA0E25E57036D547EBFC .
[16] le centre d’archivage des savoirs sensibles est une oeuvre réalisée par la compagnie québecoise création dans la chambre : https://www.creationdanslachambre.com/ .
[17] l’afrikalab est un lieu dédié à la culture, au « vivre-ensemble », à la transmission ainsi qu’à la formation en ville de genève.

QUELS RITUELS POUR LE FUTURE, QUELS RITUELS POUR LE PRÉSENT ? à propos de commémoration et d’incertitude – par Cassiane Pfund
au début
je souhaitais imaginer des rituels pour le futur
pour combler un vide
embrasser la confiance
et convoquer l’espoir
célébrer
et faire communauté
une vérité désagréable est que je ne sais plus
je ne sais plus ni où débuter
ni de quelle manière poursuivre ou m’arrêter
je ne sais pas
et ne pas savoir actuellement n’a jamais été aussi difficile
mais ai-je vraiment déjà su ?
et toi, as-tu vraiment déjà su ?
depuis la suisse, j’observe qu’un certain nombre de travaux
récents et d’expositions, de textes, de programmes de
recherche et d’appels à projets decident de
démêler, déplier, étendre, pirater, recréer, construire, défaire,
remodeler, réinventer et concevoir des futurs.
mais qu’est-ce que serait
comment sonnerait ou goûterait
un futur auquel aspirer ?
00. quelle(s) langue(s) ?
l’art de raconter des histoires ainsi que les récits souterrains ont
probablement été une manière de résister aux oppressions et
aux incertitudes, un geste permettant d’imaginer des solutions
alternatives et de se rassembler depuis que les êtres humains
ont développé le langage.
lorsque j’ai reçu l’invitation de mateo chacón pino pour l’écriture
d’un texte, ma bouche me sembla soudain asséchée comme si
ma langue avait disparu, et les mots, à peine présents une
question est alors survenue :
a-t-on besoin d’encore et encore et encore et encore plus de mots ?
dans une tentative de saisir quelque chose d’un paysage
dont mes doigts ne reconnaissent pas la plupart des textures
de futurs qui apparaissent flous
–inimaginables et distants, pourtant si proches–
je m’assieds au bord de la rivière
à la recherche de sédiments et de cailloux
pour une nouvelle langue
une langue sensible
pour ce qui est
ce qui résiste
ce qui évolue
ce qui survit
une langue qui danse
une langue qui doute et fait confiance
une langue qui écoute
une langue pour le présent
pause
la gravité est ce qui a la capacité de faire couler les corps, tout
autant qu’elle leur permet d’être soutenus, aussi longtemps
qu’un sol demeure.
– dans tous les cas
nous apprendrons à respirer
nous apprendrons à nager
iels disent
qui est nous ?
qui est iels ?
pause
à présent
ferme les yeux
ta propre peau
fondue avec la mer
se ressent comme celle translucide d’une méduse
des mammifères marines¹ apparaissent
des incendies sous-marins l’instant d’après
et la même mélodie
encore et encore
te rappelle une fondation sacrée
les créatures venues avant
celles qui – espérons-le,– viendront après
01. future(s)
si demain peut être entendu autant comme
le surlendemain
une période proche
dans quelques siècles ou décennies
ou même lorsque le soleil explosera
–et probablement un peu avant–
de quel(s) futur(s) s’agit-il ?
qu’est-ce qui est entendu par le mot «futur» ?
est-ce réellement et uniquement une question temporelle ?
et qu’est-ce qui pourrait rendre possible les futurs
auxquels aspirer ?
j’ai lu quelque part que des recherches actuelles sur la
physique quantique continuent de souligner à quel point notre
compréhension de ce qu’est le futur est lacunaire. aussi
fascinant que cela puisse être, le temps perçu comme linéaire
tendrait à se calquer en réalité sur une représentation
commune de l’existence humaine ; une ligne du temps
chronologique qui débute avec la naissance et se termine avec
la mort.
mais est-ce vraiment le cas ?
dans sa performance niagara 3000, l’artiste pamina de coulon
emprunte la citation suivante à l’auteur paolo cognetti :
le futur vient de l’amont²
pause
à présent
je ferme les yeux
la même mélodie
les créatures venues avant
celles qui viendront après
je les espère
02. où commencer ?
un point de départ pourrait être la causalité, tout en gardant
à l’esprit la complexité et l’incertitude propres à la
multifactorialité, soit lorsque différents facteurs sont impliqués.
par exemple, il est souvent difficile d’isoler un facteur
responsable de migraines car
on attribue le plus souvent ces dernières à un ensemble
d’éléments possibles, tels que l’alimentation, le stress,
certaines stimulations sensorielles, la pollution, les abus, etc.
or, la plupart du temps, lorsque ces facteurs sont
combinés, il est complexe d’identifier ce qui cause quoi,
comment, et avec quelle intensité, bien qu’une approche dite
holistique mette en lumière les notions de système et
d’écosystème.
si une partie de ce qu’un futur auquel aspirer dépend de
comment nous, en tant que sociétés, décidons d’agir, de ce que
nous, en tant que sociétés, décidons d’incarner et de nourrir,
comment le lit d’un tel futur peut il se préparer maintenant ?
comment, tout en embrassant l’inconfort de l’incertitude,
pouvons-nous trouver des passages au travers ?
comment pouvons-nous nous autoriser à faire le deuil, non en
tant que signe d’une impuissance apprise, mais plutôt en tant
que une manière d’intégrer la fragilité de la vie et ainsi
réactiver notre amour pour la planète sur laquelle nous flottons ?
et encore une fois, qui est nous ?
dans son dernier livre³, amandine gay exprime avec clarté la
nécessité d’une transformation initiée par un mouvement
intime. elle écrit :
nous aspirions à transformer la société sans avoir
pris conscience que cela commençait avec notre
propre libération des carcans que sont le
productivisme, la compétition, le besoin d’attention ou même
la précarité.⁴
sa vision offre la possibilité d’un retour à son propre corps situé
tout en décentrant les valeurs promues par la suprématie
blanche. avec lucidité, elle parle du piège de la
perpétuation des oppressions – en internalisant puis en
reproduisant ses outils – non pas avec l’intention de blâmer les
individus, mais avec celle de rappeler qu’une possible
transformation collective débute avec soi-même.
03. un savoir⁵ hiérarchisé, et les corps ?
en 2016, je suis un cours d’introduction à l’épistémologie⁶, et
rate magistralement l’examen théorique. je me souviens de
mes difficultés à rencontrer la matière, à la digérer, sentant
qu’au sein de cette approche quelque chose d’essentiel me
manquait, sans pour autant parvenir à identifier quoi. puis, j’ai
commencé à regarder autour de moi, avant de réaliser que
l’institution – au sein de laquelle j’ai essayé de me fondre non
sans anxiété – avait tendance à se revendiquer temple de la
connaissance, tout en échouant non seulement à rendre
compte d’une diversité de ces mêmes connaissances, mais
également à élargir ses perspectives, représentations et points
de vue.
une année plus tard, je rencontre marie lefebvre – une
chercheuse vivant à montréal que j’ai la joie d’appeler amie –
qui m’introduit à une pratique à la fois sociale et philosophique
dont le but est de décentrer une perception répandue de
l’intelligence dite «cérébrale» et du savoir. une telle pratique
souligne l’écoute comme nécessité – dans un sens large – ainsi
que la considération de toute personne en tant qu’agente
épistémique potentielle puisque l’on peut apprendre de
chacun-e-x. cette vision invite à la constitution d’un espace
destiné à la redistribution du pouvoir qui interroge les
stéréotypes de même que les obstacles à la légitimité.
voici une définition du savoir ttelle qu’identifiée par le centre
national de ressources textuelles et lexicales :
[l’] ensemble des connaissances d'une personne ou
d'une collectivité acquises par l'étude, par
l'observation, par l'apprentissage et/ou par l'expérience.⁷
je me demande comment pourraient coexister sans hiérarchie
différents modes d’acquisition de connaissances, et au-delà de
ces modes, comment tendre collectivement vers ce que
m’expliquait marie.
et que dire de l’accès «au savoir» ?
se pourrait-il que l’absence de corps situés au sein du champ
analytique académique fût un facteur déterminant de
la déconnexion dont j’ai fait l’expérience ?
et si c’est le cas, comment valoriser une intelligence corporelle
afin d’opérer un renversement depuis un lieu qui nous est
commun : nous faisons l’expérience et nous ressentons,
avec la sensibilité et les possibilités qui nous sont propres, donc
nous appartenons ?
cultiver des visions à long terme contribue à offrir une direction
aux actions et à entretenir un sens. pourtant, si imaginer des
futurs se révèle crucial, cela ne peut pas être suffisant en soi,
puisque l’acte d’imaginer s’inscrit dans le présent⁸, et je
préciserais même, au sein de présents situés.
un futur auquel aspirer n’adviendra pas comme par magie
sans prendre ses responsabilités
sans le démantèlement de toute forme de suprématie
sans ressentir
et revenir aux (à nos) corps avec une honnêteté radicale
04. injustice épistémique
la notion d’injustice épistémique, inventée par miranda fricker⁹,
invite à aborder la question du savoir et des connaissances
comme pouvoir. en effet, qui est perçu-e-x comme contribuant à
la production de savoirs, et qui ne l’est pas ? Quelles voix sont
entendues, lesquelles sont ignorées, lesquelles sont réduites
au silence ?
à chaque fois qu’une voix est ignorée ou réduite
au silence, ce qui sera retenu du passé rétrécit, et avec
elle une compréhension du présent. afin de ressentir le(s)
présent(s) en train d’être vécu(s), et d’imaginer différents types
de futurs possibles, il y a une nécessité manifeste d’œuvrer
en faveur de la résistance à la séparation.
à propos de séparation, wendy delorme¹⁰ – parmi de
nombreusex auteuricesx et artistes – réaffirme dans un
entretien mené par constant spina pour le magazine
censored¹¹ :
nous sommes un tout : humains, arbres, montagnes,
cours d’eau et animaux. tout le monde du vivant est
interconnecté, interdépendant. c’est très simple, c’est
une évidence, et pourtant, de par nos modes de vie
d’aujourd’hui, on ne cesse de l’oublier.¹²
un article sur l’injustice épistémique au sein du champ de
recherche de la psychiatrie fournit une compréhension de
ce concept introduit par miranda fricker :
epistemic injustice is a form of systemic discrimination
relating to the creation of knowledge. it occurs when
people from marginalized groups are denied capacity
as ‘epistemic agents’ (i.e., as creators of knowledge),
and are diminished or excluded from the process of
creating meaning. such exclusion creates conditions
in which the lived experiences of marginalized people
are primarily interpreted by people who do not share
their social position. […] as an approach, lived
experience work recognized that marginalized people are
rarely afforded the opportunity to theorize their own
experiences and generate solutions.¹³
l’injustice épistémique est une forme de
discrimination systémique qui a trait à la
production du savoir. elle intervient lorsque
des personnes appartenant à des groupes
marginalisés se voient refuser leur capacité
«d’agent épistémique» (comme créatrices de
savoir) et sont ainsi rabaissées ou exclues
des processus relatifs à sa production. une
telle exclusion produit les conditions dans
lesquelles les expériences vécues des
personnes marginalisées sont avant tout
interprétées par des personnes qui ne
partagent pas la même position sociale. […] en
tant qu’approche, le travail sur l'expérience
vécue reconnaît que les personnes
marginalisées ont rarement l'occasion de
théoriser leurs propres expériences et de
trouver des solutions.
l’article mentionne l’exploitation épistémique et en avertit
du risque, elle semble
être une autre forme d’extractivisme lorsque les expériences
vécues sont absorbées par des structures dominantes
préexistantes au sein desquelles elles deviennent des tokens¹⁴.
en réalité, la question des expériences vécues, lorsque
confrontée à une mécanique extractiviste, est profondément
interconnectée avec celle de la pensée coloniale:
[the question of the lived experiences] has
encountered an inherent problem though in seeking to
challenge western traditional valuing of positivist
approaches to research, with their emphasis on
‘objectivity’, ‘neutrality’ and ‘distance’. these are still strong
in the psych system and have distorted our
understandings of what counts as knowledge. so, if you
have direct experience of a problem, like poverty,
distress or indeed colonisation, where such research
values apply, you can expect to be granted less credibility
and your knowledge seen as less reliable
because you are ‘too close to the problem’ – it affects you
and you cannot claim to be neutral, objective and distant
from it. thus, you can expect to be seen as an inferior
knower and your knowledge less reliable. this
means effectively that if you have experience of
discrimination and oppression you can expect
routinely to face further discrimination and be further
marginalised and devalued.¹⁵
[la question des expériences vécues] a
rencontré un problème inhérent en se
confrontant à une vision occidentale
traditionaliste sur la valeur accordée aux
approches dites «positivistes» dans le
champ de la recherche, soit des approches
qui soutiennent l’«objectivité», la «neutralité»
et la «distance». ces notions, très présentes
dans le système psychiatrique, ont déformé
nos compréhensions de ce qui compte en
tant que «savoir». ainsi, lorsque certaines de
ces valeurs s’appliquent alors même que
vous faites l’expérience directe d’un
problème, tel que la pauvreté, de la détresse
ou la colonisation, vous pouvez
escompter à ce que
d’une part, l’on vous perçoive comme moins
crédible en tant que sachant, et que, d’autre part,
votre savoir ou vos connaissances risquent
d’être perçus comme moins fiables en raison de
votre «trop grande proximité avec le problème» :
car puisque cela vous affecte, vous ne pouvez
revendiquer ni neutralité, ni objectivité, ni
distance. cela implique
en réalité que si vous faites
l’expérience de discrimination et d’oppression,
vous pourriez
faire face à d’autres discriminations et
connaître régulièrement davantage de mépris
et de marginalisation.
05. savoir sensible
le centre d’archivage des savoirs sensibles est une œuvre de la
compagnie création dans la chambre¹⁶ que j’aime beaucoup.
elle met en lien l’archive populaire, le(s) savoir(s) et la mémoire.
en voici une description trouvée sur le site internet de la
compagnie, après adaptation en langage inclusif :
cette installation monumentale d’archivage populaire
offerte aux citoyen-n-e-x-s deviendra en quelque sorte
un lieu d’échange poétique d’apprentissage, sans
discrimination quant à l’autorité d’un savoir sur un
autre; nous voulons proposer un espace déhiérarchisé
où tou-x-t-e-s peuvent laisser quelque chose au monde
dans une optique de transmission. que ce soit par un
enseignement artisanal unique, une chanson cachée
dans un vieux souvenir, l’histoire d’un-e-x aïeul-e-x
transmise par l’oralité, une recette familiale ancestrale
ou l’étude toute personnelle d’un comportement
animalier, chacun pourra agir sur la mémoire collective en
perpétuelle construction.
le centre d’archivage des savoirs sensibles met en lumière une
dimension essentielle : le savoir ne peut être réduit à un seul
type ou à une catégorie. la vigilance et l’humilité sont de mise
afin d’éviter l’écueil d’une hiérarchisation entre une forme et
une autre, tout en ayant conscience d’où les savoirs
proviennent, comment ils circulent et/ou s’ils ont été
appropriés.
06. lignée et commémoration
alors que je me demande quels outils pourraient contribuer à
incarner un changement de perspective, la commémoration me
rend visite.
que restera-t-il lorsqu’il n’y aura plus personne pour se
souvenir ?
il y a plusieurs semaines, en assistant à une partie de la
rencontre organisée par l’afrikalab¹⁷, comodérée par ivan
larson ndengue, avec germaine acogny et shelly ohene-nyako,
la notion de lignée est apparue comme une manière nécessaire
à la fois d’honorer et de rappeler des personnes qui nous
ont appris, et donc, , celles qui nous ont transmis.
la commémoration est un acte d’être ensemble
un moyen de résistance collective
qui empêche l’annihilation de la mémoire
un rituel pour conserver des traces
les ramener à la vie pour un temps
avant de les transmettre plus loin
j’aime le voir comme un cycle honorant ce qui est venu avant
recevoir
écouter
apprendre
interroger
refuser
nourrir
transformer
puis confier
un cycle ayant ses rythmes propres qui requiert
présence et lenteur
conscience et proximité
être dans la conscience de ce qui a rendu possible la vie
nous invite à procéder à une chorégraphie continue
un mouvement qui défie la linéarité
convoquant d’anciens souvenirs
demandant d’ajuster
de choisir ce que nous continuerons d’honorer
ce que nous aurons transformé
– ou tenté de transformer–
d’imprimer les traces que nous laisserons
et répéter
depuis là où j’écris
et pour le moment
cette fondation demeure.
la pratique de cassiane c. pfund (BR/CH) se situe dans les interstices. en réassemblant l’écriture, l’art, la recherche et la poésie, elle considère les mots comme les points de départ d’une exploration d’autres médias, tels que la performance, les installations et la publication en tant que sculptures et expériences collectives de transmission. l’artiste désire ouvrir des espaces au ralenti dans lesquels les gens peuvent se rencontrer, partager des histoires, exprimer leurs émotions et soulever des questions.
cassiane c. pfund (*1993) vit à Genève. l’artiste a d’abord étudié la philosophie (master à l’Unige et l’UQAM, 2018), puis a souhaité éprouver et approfondir des concepts d’un point de vue artistique physique et interdisciplinaire (MasterCap HKB, 2020).
site web : cassianepfund.ch
[1] l’expression « mammifères marines » est empruntée à l’autrice et chercheuse alexis pauline gumps et à son texte non-noyées, leçons féministes noires apprises auprès des mammifères marines, traduit de l’anglais par mabeuko oberty, myriam rabah-konaté et rose b, paru aux éditions burn-août et les liens qui libèrent (2024).
[2] niagara 3000 est une performance de l’artiste et autrice pamina de coulon issue de la saga fire of emotions.
[3] gay amandine, vivre libre, exister au coeur de la suprématie blanche, cahiers libres, la découverte, octobre 2025.
[4] ibid., p.114.
[5] en anglais, le terme « knowledge » réfère indistinctement au savoir et à la connaissance, ce qui n’est pas le cas en français.
[6] le cours d’introduction à l’épistémologie est un module obligatoire au sein des études de philosophie à l’université de genève.
[7] cette définition est tirée du CNTRL : https://www.cnrtl.fr/definition/savoir .
[8] lors de son intervention au sein de l’école w.o.r.d., l’autrice et militante sarah durieux a introduit l’importance d’un ancrage du discours dans le présent à propos du storytelling et du discours politique.
[9] l’histoire retient que la notion d’injustice épidémique est formulée pour la première fois par la philosophe miranda fricker.
[10] wendy delorme est une autrice performeuse, enseignante, chercheuse et militante féministe française.
[11] censored magazine est une plateforme éditoriale où se croisent idées féministes, création émergente et transmission, au-delà des récits dominants.
[12] ibid., constant spina (2025), entretien avec wendy delorme : le roman comme un cycle de l’eau, [en ligne].
[13] celestin okoroji, tanya mackay, dan robotham, dation beckford, vanessa pinfold (2023), epistemic injustice and mental health research: e pragmatic approach to working with lived experience expertise, frontiers in psychiatry, vol. 14, [en ligne], https://www.frontiersin.org/journals/psychiatry/articles/10.3389/fpsyt.2023.1114725/full
[14] le tokénisme désigne la pratique à laquelle un groupe, ou un organisme, a recours, afin d'inclure des personnes issues des minorités, sans pour autant que de réels changements structurels soient opérés ou que ces personnes soient soutenues sur le long cours, car il est en réalité question d’une inclusion de façade.
[15] peter beresford, diana rose (2023), decolonising global mental health: the role of mad studies, cambridge prisms: global mental health, cambridge university press, [en ligne], https://www.cambridge.org/core/journals/global-mental-health/article/decolonising-global-mental-health-the-role-of-mad-studies/EEF259FE948CAA0E25E57036D547EBFC .
[16] le centre d’archivage des savoirs sensibles est une oeuvre réalisée par la compagnie québecoise création dans la chambre : https://www.creationdanslachambre.com/ .
[17] l’afrikalab est un lieu dédié à la culture, au « vivre-ensemble », à la transmission ainsi qu’à la formation en ville de genève.


The Camera Cannot Eat – par Jim Chuchu
« The Camera Cannot Eat » est un essai vidéo qui explore le dilemme de comment produire des images sur la culture alimentaire africaine lorsque chaque choix visuel (qu’il soit « traditionnel » ou « contemporain ») alimente des regards extractifs façonnés par des siècles de production d’images coloniales.
L’œuvre utilise les mêmes matériaux qu’elle critique (des images d’archives de personnes africaines cuisinant et mangeant, des images générées par IA de « nourriture africaine ») pour révéler à quel point le langage visuel de la nourriture africaine a déjà été capturé, catalogué et transformé en données.
Plutôt que de proposer des solutions, l’essai mijote dans cette tension, suggérant que ce qui ne peut être photographié — les sens du goût et de l’odorat, ainsi que l’expérience incarnée de se rassembler autour de la nourriture — est peut-être ce qui demeure préservé, encore hors de portée des circuits d’extraction.
Jim Chuchu (KE) a commencé sa pratique artistique au sein du groupe de musique alternative kényan Just a Band, créant de la musique et des œuvres visuelles jusqu’en 2012. Ses travaux visuels ont depuis été exposés au MoMA, au Vitra Design Museum et dans la collection du musée national d’Art africain de la Smithsonian Institution. Ses films ont été projetés aux festivals internationaux du film de Berlin, Toronto et Rotterdam.
En 2014, Jim a cofondé le Nest Collective, un collectif artistique multidisciplinaire basé à Nairobi, au Kenya. a multidisciplinary art collective based in Nairobi, Kenya. Leur film à sketchs queer, Stories of Our Lives, encensé par les critiques, a gagné le prix du jury des Teddy Awards de la Berlinale 2015 et a été projeté dans plus de 90 pays, malgré son interdiction au Kenya, accusé de « promouvoir l’homosexualité ».
Avec le Nest Collective, Jim a participé à l’International Inventories Programme (programme international d’inventaire), un projet de recherche international examinant la présence d’objets culturels kényans dans les institutions du monde entier. Entre 2018 et 2021, le projet a inventorié plus de 32 000 objets et a poussé le public à s’impliquer dans les débats urgents autour des déplacements d’objets et l’histoire coloniale.
Jim, en solo depuis 2021, a composé pour le documentaire Netflix À l’écoute du ventre, les secrets de votre santé (2024), nommé aux Emmy. Il fait partie de l’African Film and Media Arts Collective (AFMAC ; collectif du film et des arts des médias africains), développé par l’artiste Julie Mehretu. Actuellement, il réalise de courts documentaires pour le projet African in the Anthropocene, explorant les expériences africaines au temps de changements environnementaux et sociaux sans précédent et qui devrait sortir au début de 2026.
Ses œuvres analysent constamment les questions de représentation, de souveraineté culturelle et de politique sous-jacente à la production d’images aujourd’hui en Afrique.

The Camera Cannot Eat – par Jim Chuchu
« The Camera Cannot Eat » est un essai vidéo qui explore le dilemme de comment produire des images sur la culture alimentaire africaine lorsque chaque choix visuel (qu’il soit « traditionnel » ou « contemporain ») alimente des regards extractifs façonnés par des siècles de production d’images coloniales.
L’œuvre utilise les mêmes matériaux qu’elle critique (des images d’archives de personnes africaines cuisinant et mangeant, des images générées par IA de « nourriture africaine ») pour révéler à quel point le langage visuel de la nourriture africaine a déjà été capturé, catalogué et transformé en données.
Plutôt que de proposer des solutions, l’essai mijote dans cette tension, suggérant que ce qui ne peut être photographié — les sens du goût et de l’odorat, ainsi que l’expérience incarnée de se rassembler autour de la nourriture — est peut-être ce qui demeure préservé, encore hors de portée des circuits d’extraction.
Jim Chuchu (KE) a commencé sa pratique artistique au sein du groupe de musique alternative kényan Just a Band, créant de la musique et des œuvres visuelles jusqu’en 2012. Ses travaux visuels ont depuis été exposés au MoMA, au Vitra Design Museum et dans la collection du musée national d’Art africain de la Smithsonian Institution. Ses films ont été projetés aux festivals internationaux du film de Berlin, Toronto et Rotterdam.
En 2014, Jim a cofondé le Nest Collective, un collectif artistique multidisciplinaire basé à Nairobi, au Kenya. a multidisciplinary art collective based in Nairobi, Kenya. Leur film à sketchs queer, Stories of Our Lives, encensé par les critiques, a gagné le prix du jury des Teddy Awards de la Berlinale 2015 et a été projeté dans plus de 90 pays, malgré son interdiction au Kenya, accusé de « promouvoir l’homosexualité ».
Avec le Nest Collective, Jim a participé à l’International Inventories Programme (programme international d’inventaire), un projet de recherche international examinant la présence d’objets culturels kényans dans les institutions du monde entier. Entre 2018 et 2021, le projet a inventorié plus de 32 000 objets et a poussé le public à s’impliquer dans les débats urgents autour des déplacements d’objets et l’histoire coloniale.
Jim, en solo depuis 2021, a composé pour le documentaire Netflix À l’écoute du ventre, les secrets de votre santé (2024), nommé aux Emmy. Il fait partie de l’African Film and Media Arts Collective (AFMAC ; collectif du film et des arts des médias africains), développé par l’artiste Julie Mehretu. Actuellement, il réalise de courts documentaires pour le projet African in the Anthropocene, explorant les expériences africaines au temps de changements environnementaux et sociaux sans précédent et qui devrait sortir au début de 2026.
Ses œuvres analysent constamment les questions de représentation, de souveraineté culturelle et de politique sous-jacente à la production d’images aujourd’hui en Afrique.


Au-delà de la subsistance : l’art subtil d’être un réceptacle – par Rebecca Khamala
Il existe un adage en luganda, « Oluganda kulya, olugenda enjala teluda », qui peut se traduire par « Une relation [fraternelle] c’est manger, la relation qui a faim ne revient pas ». Au-delà de la subsistance, la nourriture est le langage de l’amour. Elle est louée. Elle est à la source de l’association avec une communauté, avec la famille et avec soi. La nourriture est une partie intime de notre héritage culturel, souvent sujet du folklore, intégrée dans des proverbes et expressions et au centre de notre culture matérielle.

1. Détail de construction de l’ekibbo enroulé avec l’enjulu
Dans de nombreuses communautés en Ouganda, la nourriture est un cadeau et les paniers en sont le papier cadeau. Un panier n’est jamais seulement un panier. C’est un réceptacle, pour servir le millet, pour faire sécher au soleil les champignons ramassés à l’heure de la rosée, pour transporter les ignames des champs à la maison, pour le prix de la fiancée offert lors de l’okwanjula¹. Ce sont des instruments de la vie quotidienne. Tout comme l’art offre un aperçu de la culture, les paniers proposent un angle unique sur les cultures alimentaires en Ouganda. La fabrication des paniers est une tradition importante et profondément enracinée dans l’héritage culturel ougandais. Elle fait aussi partie d’un héritage artistique plus large, ancré dans la culture matérielle du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi. Comme dans d’autres nombreuses cultures africaines, l’expression artistique fut une partie intégrante du tissu social et culturel des communautés de cette région. L’art est africain a donné la priorité aux objets fonctionnels plutôt qu’aux objets figuratifs. Ces articles étaient confectionnés à l’aide de matériaux provenant de l’environnement immédiat, reflétant le mélange harmonieux entre la fonction et le talent artistique et tirant son inspiration des rythmes et des nécessités de la vie quotidienne. Pour comprendre ce riche héritage culturel, il faut regarder au-delà des frontières géopolitiques, produits de l’entreprise coloniale, et se concentrer plutôt sur les diverses cultures et structures sociales qui ont précédé la colonisation. Rien qu’en Ouganda, 56 tribus sont reconnues, chacune avec sa langue, ses coutumes, sa cuisine et sa culture matérielle. Bien que propres à des groupes individuels, les variétés linguistiques et coutumes révèlent des connexions historiques, géographiques et culturelles profondes parmi les différentes communautés au sein et au-delà des frontières nationales.
Cet article commence par le panier, non pas à cause de sa rareté ou de son ornementation, mais bien parce qu’il est ordinaire. Les paniers font partie d’une chorégraphie silencieuse de la vie : les femmes qui trient des grains, les vendeur·euses de rue équilibrant des paniers de bananes sur leur tête et les jjajjas² assis sur la terrasse couverte, enroulant l’obukeedo en des spirales serrées et se rappelant des histoires de temps depuis longtemps révolus. Les paniers sont des objets quotidiens, des archives silencieuses avec des histoires sur la terre, le travail et la vie. Suivre leur tressage permet de tracer les relations délicates et changeantes entre les gens, les écosystèmes et les cultures alimentaires en Ouganda et en Afrique de l’est. Au fil des années, j’ai développé une pratique se situant entre l’art et l’architecture, poussée par une curiosité profonde envers les gens, la culture et l’environnement. Ma pratique se concentre sur la culture matérielle et le design contemporain. Je recherche des artisanats traditionnels en collaboration avec des artisan·es loca·les et les adapte à la vie contemporaine. Dans ma quête pour trouver une identité conceptuelle africaine et ougandaise, je suis tombée sur des objets banals, les e kibbo n’omukeekka, qu’on trouve dans presque tout foyer bien décoré en Ouganda. Lorsque j’ai commencé à analyser la matérialité et la forme d’un panier, dans l’espoir de prendre ce qui était local comme inspiration et information pour mon travail de design et d’architecture, je me suis rendu compte que, même si j’avais grandi avec ces objets, je n’avais aucune idée de leur fabrication, que ce soit en matière de matériau ou de technique. Donc j’ai commencé à explorer, d’abord en déconstruisant. Plus je le faisais, plus mon ignorance m’était évidente. Je ne m’étais pas rendu compte qu’il y avait tant de sortes de paniers. Au Buganda³, par exemple, le kikapu est un panier pour faire les courses au marché, tressé avec des feuilles de palmes, similaire à un tote bag ; le kisero est un panier profond et large utilisé pour récolter des aliments dans les champs et parfois pour entreposer de la nourriture ; l’ekiyonjo est une cage tressée pour transporter des poulets et protéger les poules ; l’ekiwewa/olugali est un plateau pour trier les grains ; l’enzibo est un piège tressé pour attraper des ensonzi ; et l’ekibbo est utilisé pour stocker, préparer et servir la nourriture. Ces paniers, et bien d’autres encore, se trouvent dans tout le pays, avec des variations de design et des matérialités reflétant les nourritures locales, les systèmes alimentaires et les écosystèmes environnants.


1. Cultiver les rythmes du soin – Installation KLA Art 24
2. Principaux groupes ethniques en Ouganda en 2001
L’enquête autour des paniers signifiait aussi rencontrer les personnes qui les fabriquent et interagir avec les écosystèmes d’où les matériaux viennent. La plupart des paniers sont traditionnellement tressés par des femmes, dans leur temps libre, entre leurs tâches ménagères, en parallèle de la culture et pendant la préparation de la nourriture. Les rôles genrés traditionnels dictent une division du travail dans laquelle les femmes s’occupent principalement des tâches ménagères et de l’agriculture de subsistance, alors que les hommes se concentrent sur les cultures de rente et le travail rémunéré. Ainsi, les décisions autour de la nourriture et la nutrition et, par extension, la fabrication des réceptacles qui transportent les aliments sont laissées exclusivement à la femme. Les paniers sont tressés à partir de plantes : fibre de banane, papyrus, raphia, feuilles et tiges de palme, roseaux et herbacées. Chaque plante est choisie en fonction de sa flexibilité, sa texture et sa disponibilité locale. La production de paniers demande de grandes connaissances écologiques, pour savoir où pousse telle herbacée, à quel moment sa tige est la plus robuste, comment l’écorcher en fil et quelles plantes produisent des teintures grand teint.
Je fus surprise d’apprendre que le kibbo ou ekibbo, un des paniers les plus répandus en Ouganda, est fabriqué avec des plants de bananiers. Il est fait d’obukeedo torsadé avec une couche supérieure d’enjulu, un roseau similaire au papyrus qui se trouve dans les zones humides. Le kibbo est en général utilisé pour transporter de la nourriture, stocker, préparer et servir les matooke. Les Matooke sont un aliment de base dans le centre de l’Ouganda, mais aussi dans l’ouest du pays ainsi qu’au Rwanda et en Tanzanie. C’est une des nombreuses variétés autochtones de bananes des régions d’altitude en Afrique de l’Est, qui s’est développé en Ouganda même si les bananes ne sont pas originaires de la région. Le Matooke se prépare de diverses manières, mais surtout en purée de matooke, cuit à la vapeur et écrasé dans des feuilles de bananiers, un plat signature du Buganda. Elle est en général accompagnée d’une purée d’arachides, nature ou cuite avec des champignons déshydratés, de viande fumée, de poisson fumé ou de malewa⁴. Le Matooke se prépare aussi entier dans le katogo⁵. Les bananes sont aussi utilisées pour faire de l’omubisi⁶, fait d’une variété de bananes appelée embidde et qui peut être fermentée pour en faire une bière. D’autres variétés communes sont par exemple les bogoya, une banane dessert servie et mangée comme un fruit ; les ndiizi, un type de banane plus court et plus sucré, souvent utilisé pour faire des kabalagala⁷ ; les gonja, des bananes plantain en général rôties et vendues sur les marchés en bordure de route ; et enfin, les kivuuvu, une variété de banane plantain plus charnue et légèrement moins sucrée que la gonja et qui est d’habitude cuite à la vapeur avec sa peau et servie avec d’autres glucides, comme l’igname, les courges, les patates douces et le manioc.


1.A display of different banana varieties from the Cultivating Rhythms of Care Kla Art 24 installation
2. A decorative basket from Fort Portal by Mr. Akiiki one of the facilitators for the KLA Art 24 workshops
Un autre cas intrigant est l’endiiro. C’est un panier ouvert sur le dessus, cylindrique avec un couvercle ajusté, fait pour servir le pain de millet, courant chez les Batooro et aussi utilisé par les Banyankole de la tribu des Ankole⁸. L’endiiro est fabriqué à l’aide de paille de millet, un sous-produit de la récolte de l’éleusine. D’autres tribus au sein de la grande région de Rwenzori en Ouganda de l’Est intègrent aussi les tiges ou la paille de millet dans la construction de paniers, qui sont enroulées avec du raphia coloré par des teintures de plantes des régions d’altitude voisines. L’éleusine est un aliment de base chez les communautés ethniques nilotiques, nilo-hamites et bantu dans le nord, l’est et l’ouest de l’Ouganda. C’est une céréale autochtone de l’Afrique de l’Est qu’on dit originaire des montagnes d’Ouganda et d’Éthiopie. L’éleusine est une céréale riche en nutriments qui pousse bien dans divers environnements et conditions, ce qui est profitable dans des régions sujettes aux famines. Elle occupe 50 % des zones céréalières d’Ouganda et fait partie intégrante des fonctions culturelles dans le pays. L’éleusine est servie lors de mariages, de cérémonies de baptême et lors de festivals célébrant la nouvelle récolte. Elle est consommée sous différentes formes, notamment en pain d’éleusine, en général accompagné de malakwang⁹ dans le nord de l’Ouganda ; d’eshabwe¹⁰ et en Firinda dans l’ouest de l’Ouganda, dans les communautés fermières et d’élevage ; de viande rôtie dans le nord-est de l’Ouganda, parmi les communautés nomades ; et de poisson fumé dans les communautés pêcheuses, dans l’est du pays. L’éleusine est aussi mangée en porridge, en boisson fermentée, bushera et en bière. Diverses variétés sont utilisées pour des consommations spécifiques : par exemple, les Itesots de la tribu des Teso préfèrent la variété appelée emoru pour faire de l’ajon, une bière bue lors des célébrations de nouvelles récoltes.
La confection à la fois de la nourriture et des paniers est un processus très physique et intuitif, notamment l’acte d’okuyubuguluza olulagala, c’est-à-dire le retrait des pétioles de bananes à plat pour faire la cuisine, en gardant la tige intacte pour pouvoir l’effilocher en obukeedo pour fabriquer les ekibbo. Ces connaissances incarnées ont longtemps été transmises de génération en génération, des femmes plus âgées aux femmes plus jeunes. Cette éducation informelle façonne de plus en plus ma pratique et donc ma vie. Pour notre projet KLA ART en 2024, ma collaboratrice Birungi Kawooya et moi avons exploré la manière dont nos ancêtres prenaient soin de leurs corps, en s’appuyant sur l’histoire de Njabala. Dans cette dernière, une fille mariée et gâtée est guidée par le fantôme de sa mère pour apprendre à cultiver « abakazi balima bati¹¹», un principe de la culture ougandaise. Nous avons analysé l’accent sur la culture dans ce folklore et nous nous sommes posé les questions suivantes : pourquoi était-ce spécifiquement la chose que Njabala devait apprendre de sa mère ? Cultiver, qu’est-ce que ça veut dire ?


1. Un vendeur de rue vendant des haricots dans une variante d’ekibbo
2. Une variante d’ekisero
Les femmes sont depuis longtemps les gardiennes de l’inestimable savoir nutritionnel et écologique : elles comprennent quels aliments prospèrent à chaque saison, quel légume augmente les niveaux de fer et comment nourrir leurs corps en accord avec les cycles mensuels et les saisons annuelles. Pour suivre le temps, les fermier·es suivaient le mouvement de la Lune, observant l’avancement des mois et des saisons. De manière similaire, les femmes suivaient souvent leurs cycles menstruels grâce aux phases de lune. Se tourner vers la terre signifiait prendre soin de leurs corps. Il était habituel (en particulier au Buganda) de planter des arbres fruitiers autour de la maison. Il était aussi courant que les femmes fassent pousser des légumes et les préparent au quotidien, surtout à la vapeur dans des feuilles de bananiers, à côté d’autres glucides. Ainsi, elles s’assuraient de la diversité alimentaire nécessaire à leur santé. Une des pratiques essentielles, encore aujourd’hui, consiste à faire pousser des plantes médicinales autour de la maison, en particulier celles utiles à la santé reproductive des femmes. Dans certaines communautés, notamment chez les Basoga, les femmes n’étaient et ne sont toujours pas autorisées à exercer certaines activités lors de leurs menstruations, telles que la récolte de feuilles de palme pour le tissage, à cause de la croyance selon laquelle l’arbre disparaîtrait. Ces tabous, en apparence restrictifs, étaient en fait une forme de soin de soi-même, encourageant le repos et honorant le rythme naturel du corps. À travers ces pratiques, nos ancêtres étaient non seulement les coordinatrices de la terre, mais aussi les gardiennes de sa sagesse. En s’accordant aux rythmes naturels de la terre et de leur corps, elles incarnaient une connexion profonde à une conscience plus grande et devenaient des réceptacles de la transmission du savoir.
Une grande partie des légumes présents dans les régimes en Afrique de l’Est sont sauvages, et certaines communautés, telles que celles de la région de Teso-Karamoja, continuent à dépendre de plantes sauvages comestibles, en particulier lors de périodes de pénurie alimentaire. Alors que nos paysages sauvages s’urbanisent progressivement, nos systèmes alimentaires évoluent également, aux côtés des réceptacles qui les fortifient. Nous sommes témoins des évolutions matérielles des pratiques traditionnelles, où le plastique continue de remplacer les matériaux naturels : par exemple dans la production de bikapu¹² avec des brins en plastique dur et de la corde en plastique à la place du raphia. Le plastique a envahi la préparation de nourriture aussi, principalement en couche supplémentaire ou en remplacement des ndagala¹³ utilisées pour cuire à la vapeur des aliments, comme les matooke ou le maize pour mieux garder l’humidité.
Ce changement révèle une plus grande inclinaison vers ce qui est pratique et durable, où la combinaison d’une croissance rapide de la population, des changements de manières de vie et d’une urbanisation rapide crée les conditions pour le développement de produits alimentaires, tels que la farine et les biscuits de matooke, et la prise de contrôle de la commercialisation de produits, comme les bushera et mubisi par des entreprises privées de boissons. En même temps, l’agriculture industrielle, la déforestation et la récupération des marécages détruisent les habitats naturels des plantes servant de matériaux des paniers : les marécages sont asséchés pour les constructions, les herbes autochtones disparaissent à cause de l’agriculture commerciale et, en même temps, les systèmes alimentaires mondiaux introduisent des importations conditionnées et des emballages en plastique, déplaçant le besoin et le savoir des paniers traditionnels.
En décodant le panier, j’ai ouvert de nouveaux canaux de dialogue et d’interaction avec ma famille, en particulier avec mes parents, avec mes ami·es et avec l’environnement. Ma pratique évolue doucement vers une conversation : entre les matériaux, les traditions, les personnes et l’environnement. Je ne vois plus les paniers comme les objets décoratifs faits à la main auxquels on les réduit souvent, mais comme des réflexions sur un système alimentaire résilient, l’incarnation du soin, de l’adaptation et de la restauration face aux perturbations écologiques et coloniales. Des étals du marché et cuisines familiales aux rassemblements cérémonieux et échanges de cadeaux, les paniers (à la fois archives et pratiques) restent une partie intégrante de la vie quotidienne de différentes cultures de la région. Chacun a une raison d’être, porte une forme et raconte une histoire.
Devenir consciente de ceci a fait naître en moi un sens renouvelé du devoir, celui de prendre du recul et de m’autoriser à évoluer à un rythme plus grand que moi. Apprendre l’art subtil d’être un intermédiaire ; me soumettre à des systèmes de connaissances plus larges ; laisser le lieu et le matériel me guider ; apprendre par la participation, l’observation et le jeu : tout cela en devenant progressivement plus au fait des relations cycliques et intimement interconnectées qui façonnent nos cultures matérielles et les systèmes alimentaires.



1. La construction d’un panier en papyrus pour transporter du poisson, à Busia (Ouganda)
2. L’ekitaferi (corossol en luganda) dans un ekibbo enroulé de brins de plastique au lieu d’enjulu ou de raphia
3. Du matooke servi dans un ekibbo
Rebecca Khamala (UG) est une designer, artiste et écrivaine multidisciplinaire avec de l’expérience en architecture. Sa pratique s’articule autour du travail en harmonie avec la nature et le lieu. Elle est motivée par une forte curiosité envers les personnes, la culture et l’environnement. Elle se concentre sur les pratiques régénératives, les matériaux locaux et les technologies. En collaboration avec des artisan·es, elle adapte les artisanats traditionnels aux conceptions contemporaines. Sa recherche plonge dans les relations complexes entre les cultures matérielles, les cultures alimentaires et les écosystèmes locaux.
En parallèle, Rebecca s’implique dans l’exploration continue des espaces publics à Kampala, examinant comment ces environnements peuvent donner lieu à des mobilisations et loisirs communautaires. Elle s’intéresse notamment aux manières dont les loisirs peuvent servir d’outils de reconnexion entre les gens, mais aussi avec leur environnement naturel, redonnant un sentiment d’appartenance et de gestion au sein de milieux urbains. Cette recherche se prolonge sur des questions de connexion culturelle à la nature, explorant comme les systèmes de savoir et pratiques culturelles traditionnels peuvent façonner la forme des espaces urbains et les revitaliser en les transformant en des lieux de connexion, de vitalité et de conscience écologique.
La poésie fait partie intégrante de son processus créatif, servant souvent de base qu’elle traduit en formes visuelles, spatiales et tactiles. Elle travaille sur plusieurs médias (poésie, film, performance et design). Elle raconte ainsi des histoires inspirantes en des lieux spécifiques qui honorent la communauté et le contexte, envisageant une relation plus connectée et régénérante entre les humains, la culture et le monde naturel.
[1] Cérémonie de mariage traditionnelle au Bugunda, un royaume en Ouganda
[2] Grand-parents
[3] Le peuple baganda est la plus grande communauté ethnique Bantu en Ouganda et occupe la région centrale, le royaume de Buganda.
[4] Pousses de bamboo fumées, plat traditionnel des Bagisu, un groupe ethnique Bantu qui occupe la région du mont Elgon, dans l’est de l’Ouganda.
[5] Un plat dans lequel les aliments sont cuits dans la sauce
[6] Jus de banane
[7] Une crêpe ougandaise à base de farine de manioc, de bananes desserts mûres et d’une pincée de bicarbonate de soude.
[8] Un groupe ethnique Bantu en Ouganda de l’Ouest
[9] Une purée d’arachides et de sésame avec de la sauce aux légumes
[10] Sauce de beurre clarifié
[11] C’est ainsi que les femmes cultivent
[12] Pluriel de kikapu
[13] Feuilles de bananier

Au-delà de la subsistance : l’art subtil d’être un réceptacle – par Rebecca Khamala
Il existe un adage en luganda, « Oluganda kulya, olugenda enjala teluda », qui peut se traduire par « Une relation [fraternelle] c’est manger, la relation qui a faim ne revient pas ». Au-delà de la subsistance, la nourriture est le langage de l’amour. Elle est louée. Elle est à la source de l’association avec une communauté, avec la famille et avec soi. La nourriture est une partie intime de notre héritage culturel, souvent sujet du folklore, intégrée dans des proverbes et expressions et au centre de notre culture matérielle.

1. Détail de construction de l’ekibbo enroulé avec l’enjulu
Dans de nombreuses communautés en Ouganda, la nourriture est un cadeau et les paniers en sont le papier cadeau. Un panier n’est jamais seulement un panier. C’est un réceptacle, pour servir le millet, pour faire sécher au soleil les champignons ramassés à l’heure de la rosée, pour transporter les ignames des champs à la maison, pour le prix de la fiancée offert lors de l’okwanjula¹. Ce sont des instruments de la vie quotidienne. Tout comme l’art offre un aperçu de la culture, les paniers proposent un angle unique sur les cultures alimentaires en Ouganda. La fabrication des paniers est une tradition importante et profondément enracinée dans l’héritage culturel ougandais. Elle fait aussi partie d’un héritage artistique plus large, ancré dans la culture matérielle du Kenya, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi. Comme dans d’autres nombreuses cultures africaines, l’expression artistique fut une partie intégrante du tissu social et culturel des communautés de cette région. L’art est africain a donné la priorité aux objets fonctionnels plutôt qu’aux objets figuratifs. Ces articles étaient confectionnés à l’aide de matériaux provenant de l’environnement immédiat, reflétant le mélange harmonieux entre la fonction et le talent artistique et tirant son inspiration des rythmes et des nécessités de la vie quotidienne. Pour comprendre ce riche héritage culturel, il faut regarder au-delà des frontières géopolitiques, produits de l’entreprise coloniale, et se concentrer plutôt sur les diverses cultures et structures sociales qui ont précédé la colonisation. Rien qu’en Ouganda, 56 tribus sont reconnues, chacune avec sa langue, ses coutumes, sa cuisine et sa culture matérielle. Bien que propres à des groupes individuels, les variétés linguistiques et coutumes révèlent des connexions historiques, géographiques et culturelles profondes parmi les différentes communautés au sein et au-delà des frontières nationales.
Cet article commence par le panier, non pas à cause de sa rareté ou de son ornementation, mais bien parce qu’il est ordinaire. Les paniers font partie d’une chorégraphie silencieuse de la vie : les femmes qui trient des grains, les vendeur·euses de rue équilibrant des paniers de bananes sur leur tête et les jjajjas² assis sur la terrasse couverte, enroulant l’obukeedo en des spirales serrées et se rappelant des histoires de temps depuis longtemps révolus. Les paniers sont des objets quotidiens, des archives silencieuses avec des histoires sur la terre, le travail et la vie. Suivre leur tressage permet de tracer les relations délicates et changeantes entre les gens, les écosystèmes et les cultures alimentaires en Ouganda et en Afrique de l’est. Au fil des années, j’ai développé une pratique se situant entre l’art et l’architecture, poussée par une curiosité profonde envers les gens, la culture et l’environnement. Ma pratique se concentre sur la culture matérielle et le design contemporain. Je recherche des artisanats traditionnels en collaboration avec des artisan·es loca·les et les adapte à la vie contemporaine. Dans ma quête pour trouver une identité conceptuelle africaine et ougandaise, je suis tombée sur des objets banals, les e kibbo n’omukeekka, qu’on trouve dans presque tout foyer bien décoré en Ouganda. Lorsque j’ai commencé à analyser la matérialité et la forme d’un panier, dans l’espoir de prendre ce qui était local comme inspiration et information pour mon travail de design et d’architecture, je me suis rendu compte que, même si j’avais grandi avec ces objets, je n’avais aucune idée de leur fabrication, que ce soit en matière de matériau ou de technique. Donc j’ai commencé à explorer, d’abord en déconstruisant. Plus je le faisais, plus mon ignorance m’était évidente. Je ne m’étais pas rendu compte qu’il y avait tant de sortes de paniers. Au Buganda³, par exemple, le kikapu est un panier pour faire les courses au marché, tressé avec des feuilles de palmes, similaire à un tote bag ; le kisero est un panier profond et large utilisé pour récolter des aliments dans les champs et parfois pour entreposer de la nourriture ; l’ekiyonjo est une cage tressée pour transporter des poulets et protéger les poules ; l’ekiwewa/olugali est un plateau pour trier les grains ; l’enzibo est un piège tressé pour attraper des ensonzi ; et l’ekibbo est utilisé pour stocker, préparer et servir la nourriture. Ces paniers, et bien d’autres encore, se trouvent dans tout le pays, avec des variations de design et des matérialités reflétant les nourritures locales, les systèmes alimentaires et les écosystèmes environnants.


1. Cultiver les rythmes du soin – Installation KLA Art 24
2. Principaux groupes ethniques en Ouganda en 2001
L’enquête autour des paniers signifiait aussi rencontrer les personnes qui les fabriquent et interagir avec les écosystèmes d’où les matériaux viennent. La plupart des paniers sont traditionnellement tressés par des femmes, dans leur temps libre, entre leurs tâches ménagères, en parallèle de la culture et pendant la préparation de la nourriture. Les rôles genrés traditionnels dictent une division du travail dans laquelle les femmes s’occupent principalement des tâches ménagères et de l’agriculture de subsistance, alors que les hommes se concentrent sur les cultures de rente et le travail rémunéré. Ainsi, les décisions autour de la nourriture et la nutrition et, par extension, la fabrication des réceptacles qui transportent les aliments sont laissées exclusivement à la femme. Les paniers sont tressés à partir de plantes : fibre de banane, papyrus, raphia, feuilles et tiges de palme, roseaux et herbacées. Chaque plante est choisie en fonction de sa flexibilité, sa texture et sa disponibilité locale. La production de paniers demande de grandes connaissances écologiques, pour savoir où pousse telle herbacée, à quel moment sa tige est la plus robuste, comment l’écorcher en fil et quelles plantes produisent des teintures grand teint.
Je fus surprise d’apprendre que le kibbo ou ekibbo, un des paniers les plus répandus en Ouganda, est fabriqué avec des plants de bananiers. Il est fait d’obukeedo torsadé avec une couche supérieure d’enjulu, un roseau similaire au papyrus qui se trouve dans les zones humides. Le kibbo est en général utilisé pour transporter de la nourriture, stocker, préparer et servir les matooke. Les Matooke sont un aliment de base dans le centre de l’Ouganda, mais aussi dans l’ouest du pays ainsi qu’au Rwanda et en Tanzanie. C’est une des nombreuses variétés autochtones de bananes des régions d’altitude en Afrique de l’Est, qui s’est développé en Ouganda même si les bananes ne sont pas originaires de la région. Le Matooke se prépare de diverses manières, mais surtout en purée de matooke, cuit à la vapeur et écrasé dans des feuilles de bananiers, un plat signature du Buganda. Elle est en général accompagnée d’une purée d’arachides, nature ou cuite avec des champignons déshydratés, de viande fumée, de poisson fumé ou de malewa⁴. Le Matooke se prépare aussi entier dans le katogo⁵. Les bananes sont aussi utilisées pour faire de l’omubisi⁶, fait d’une variété de bananes appelée embidde et qui peut être fermentée pour en faire une bière. D’autres variétés communes sont par exemple les bogoya, une banane dessert servie et mangée comme un fruit ; les ndiizi, un type de banane plus court et plus sucré, souvent utilisé pour faire des kabalagala⁷ ; les gonja, des bananes plantain en général rôties et vendues sur les marchés en bordure de route ; et enfin, les kivuuvu, une variété de banane plantain plus charnue et légèrement moins sucrée que la gonja et qui est d’habitude cuite à la vapeur avec sa peau et servie avec d’autres glucides, comme l’igname, les courges, les patates douces et le manioc.


1.A display of different banana varieties from the Cultivating Rhythms of Care Kla Art 24 installation
2. A decorative basket from Fort Portal by Mr. Akiiki one of the facilitators for the KLA Art 24 workshops
Un autre cas intrigant est l’endiiro. C’est un panier ouvert sur le dessus, cylindrique avec un couvercle ajusté, fait pour servir le pain de millet, courant chez les Batooro et aussi utilisé par les Banyankole de la tribu des Ankole⁸. L’endiiro est fabriqué à l’aide de paille de millet, un sous-produit de la récolte de l’éleusine. D’autres tribus au sein de la grande région de Rwenzori en Ouganda de l’Est intègrent aussi les tiges ou la paille de millet dans la construction de paniers, qui sont enroulées avec du raphia coloré par des teintures de plantes des régions d’altitude voisines. L’éleusine est un aliment de base chez les communautés ethniques nilotiques, nilo-hamites et bantu dans le nord, l’est et l’ouest de l’Ouganda. C’est une céréale autochtone de l’Afrique de l’Est qu’on dit originaire des montagnes d’Ouganda et d’Éthiopie. L’éleusine est une céréale riche en nutriments qui pousse bien dans divers environnements et conditions, ce qui est profitable dans des régions sujettes aux famines. Elle occupe 50 % des zones céréalières d’Ouganda et fait partie intégrante des fonctions culturelles dans le pays. L’éleusine est servie lors de mariages, de cérémonies de baptême et lors de festivals célébrant la nouvelle récolte. Elle est consommée sous différentes formes, notamment en pain d’éleusine, en général accompagné de malakwang⁹ dans le nord de l’Ouganda ; d’eshabwe¹⁰ et en Firinda dans l’ouest de l’Ouganda, dans les communautés fermières et d’élevage ; de viande rôtie dans le nord-est de l’Ouganda, parmi les communautés nomades ; et de poisson fumé dans les communautés pêcheuses, dans l’est du pays. L’éleusine est aussi mangée en porridge, en boisson fermentée, bushera et en bière. Diverses variétés sont utilisées pour des consommations spécifiques : par exemple, les Itesots de la tribu des Teso préfèrent la variété appelée emoru pour faire de l’ajon, une bière bue lors des célébrations de nouvelles récoltes.
La confection à la fois de la nourriture et des paniers est un processus très physique et intuitif, notamment l’acte d’okuyubuguluza olulagala, c’est-à-dire le retrait des pétioles de bananes à plat pour faire la cuisine, en gardant la tige intacte pour pouvoir l’effilocher en obukeedo pour fabriquer les ekibbo. Ces connaissances incarnées ont longtemps été transmises de génération en génération, des femmes plus âgées aux femmes plus jeunes. Cette éducation informelle façonne de plus en plus ma pratique et donc ma vie. Pour notre projet KLA ART en 2024, ma collaboratrice Birungi Kawooya et moi avons exploré la manière dont nos ancêtres prenaient soin de leurs corps, en s’appuyant sur l’histoire de Njabala. Dans cette dernière, une fille mariée et gâtée est guidée par le fantôme de sa mère pour apprendre à cultiver « abakazi balima bati¹¹», un principe de la culture ougandaise. Nous avons analysé l’accent sur la culture dans ce folklore et nous nous sommes posé les questions suivantes : pourquoi était-ce spécifiquement la chose que Njabala devait apprendre de sa mère ? Cultiver, qu’est-ce que ça veut dire ?


1. Un vendeur de rue vendant des haricots dans une variante d’ekibbo
2. Une variante d’ekisero
Les femmes sont depuis longtemps les gardiennes de l’inestimable savoir nutritionnel et écologique : elles comprennent quels aliments prospèrent à chaque saison, quel légume augmente les niveaux de fer et comment nourrir leurs corps en accord avec les cycles mensuels et les saisons annuelles. Pour suivre le temps, les fermier·es suivaient le mouvement de la Lune, observant l’avancement des mois et des saisons. De manière similaire, les femmes suivaient souvent leurs cycles menstruels grâce aux phases de lune. Se tourner vers la terre signifiait prendre soin de leurs corps. Il était habituel (en particulier au Buganda) de planter des arbres fruitiers autour de la maison. Il était aussi courant que les femmes fassent pousser des légumes et les préparent au quotidien, surtout à la vapeur dans des feuilles de bananiers, à côté d’autres glucides. Ainsi, elles s’assuraient de la diversité alimentaire nécessaire à leur santé. Une des pratiques essentielles, encore aujourd’hui, consiste à faire pousser des plantes médicinales autour de la maison, en particulier celles utiles à la santé reproductive des femmes. Dans certaines communautés, notamment chez les Basoga, les femmes n’étaient et ne sont toujours pas autorisées à exercer certaines activités lors de leurs menstruations, telles que la récolte de feuilles de palme pour le tissage, à cause de la croyance selon laquelle l’arbre disparaîtrait. Ces tabous, en apparence restrictifs, étaient en fait une forme de soin de soi-même, encourageant le repos et honorant le rythme naturel du corps. À travers ces pratiques, nos ancêtres étaient non seulement les coordinatrices de la terre, mais aussi les gardiennes de sa sagesse. En s’accordant aux rythmes naturels de la terre et de leur corps, elles incarnaient une connexion profonde à une conscience plus grande et devenaient des réceptacles de la transmission du savoir.
Une grande partie des légumes présents dans les régimes en Afrique de l’Est sont sauvages, et certaines communautés, telles que celles de la région de Teso-Karamoja, continuent à dépendre de plantes sauvages comestibles, en particulier lors de périodes de pénurie alimentaire. Alors que nos paysages sauvages s’urbanisent progressivement, nos systèmes alimentaires évoluent également, aux côtés des réceptacles qui les fortifient. Nous sommes témoins des évolutions matérielles des pratiques traditionnelles, où le plastique continue de remplacer les matériaux naturels : par exemple dans la production de bikapu¹² avec des brins en plastique dur et de la corde en plastique à la place du raphia. Le plastique a envahi la préparation de nourriture aussi, principalement en couche supplémentaire ou en remplacement des ndagala¹³ utilisées pour cuire à la vapeur des aliments, comme les matooke ou le maize pour mieux garder l’humidité.
Ce changement révèle une plus grande inclinaison vers ce qui est pratique et durable, où la combinaison d’une croissance rapide de la population, des changements de manières de vie et d’une urbanisation rapide crée les conditions pour le développement de produits alimentaires, tels que la farine et les biscuits de matooke, et la prise de contrôle de la commercialisation de produits, comme les bushera et mubisi par des entreprises privées de boissons. En même temps, l’agriculture industrielle, la déforestation et la récupération des marécages détruisent les habitats naturels des plantes servant de matériaux des paniers : les marécages sont asséchés pour les constructions, les herbes autochtones disparaissent à cause de l’agriculture commerciale et, en même temps, les systèmes alimentaires mondiaux introduisent des importations conditionnées et des emballages en plastique, déplaçant le besoin et le savoir des paniers traditionnels.
En décodant le panier, j’ai ouvert de nouveaux canaux de dialogue et d’interaction avec ma famille, en particulier avec mes parents, avec mes ami·es et avec l’environnement. Ma pratique évolue doucement vers une conversation : entre les matériaux, les traditions, les personnes et l’environnement. Je ne vois plus les paniers comme les objets décoratifs faits à la main auxquels on les réduit souvent, mais comme des réflexions sur un système alimentaire résilient, l’incarnation du soin, de l’adaptation et de la restauration face aux perturbations écologiques et coloniales. Des étals du marché et cuisines familiales aux rassemblements cérémonieux et échanges de cadeaux, les paniers (à la fois archives et pratiques) restent une partie intégrante de la vie quotidienne de différentes cultures de la région. Chacun a une raison d’être, porte une forme et raconte une histoire.
Devenir consciente de ceci a fait naître en moi un sens renouvelé du devoir, celui de prendre du recul et de m’autoriser à évoluer à un rythme plus grand que moi. Apprendre l’art subtil d’être un intermédiaire ; me soumettre à des systèmes de connaissances plus larges ; laisser le lieu et le matériel me guider ; apprendre par la participation, l’observation et le jeu : tout cela en devenant progressivement plus au fait des relations cycliques et intimement interconnectées qui façonnent nos cultures matérielles et les systèmes alimentaires.



1. La construction d’un panier en papyrus pour transporter du poisson, à Busia (Ouganda)
2. L’ekitaferi (corossol en luganda) dans un ekibbo enroulé de brins de plastique au lieu d’enjulu ou de raphia
3. Du matooke servi dans un ekibbo
Rebecca Khamala (UG) est une designer, artiste et écrivaine multidisciplinaire avec de l’expérience en architecture. Sa pratique s’articule autour du travail en harmonie avec la nature et le lieu. Elle est motivée par une forte curiosité envers les personnes, la culture et l’environnement. Elle se concentre sur les pratiques régénératives, les matériaux locaux et les technologies. En collaboration avec des artisan·es, elle adapte les artisanats traditionnels aux conceptions contemporaines. Sa recherche plonge dans les relations complexes entre les cultures matérielles, les cultures alimentaires et les écosystèmes locaux.
En parallèle, Rebecca s’implique dans l’exploration continue des espaces publics à Kampala, examinant comment ces environnements peuvent donner lieu à des mobilisations et loisirs communautaires. Elle s’intéresse notamment aux manières dont les loisirs peuvent servir d’outils de reconnexion entre les gens, mais aussi avec leur environnement naturel, redonnant un sentiment d’appartenance et de gestion au sein de milieux urbains. Cette recherche se prolonge sur des questions de connexion culturelle à la nature, explorant comme les systèmes de savoir et pratiques culturelles traditionnels peuvent façonner la forme des espaces urbains et les revitaliser en les transformant en des lieux de connexion, de vitalité et de conscience écologique.
La poésie fait partie intégrante de son processus créatif, servant souvent de base qu’elle traduit en formes visuelles, spatiales et tactiles. Elle travaille sur plusieurs médias (poésie, film, performance et design). Elle raconte ainsi des histoires inspirantes en des lieux spécifiques qui honorent la communauté et le contexte, envisageant une relation plus connectée et régénérante entre les humains, la culture et le monde naturel.
[1] Cérémonie de mariage traditionnelle au Bugunda, un royaume en Ouganda
[2] Grand-parents
[3] Le peuple baganda est la plus grande communauté ethnique Bantu en Ouganda et occupe la région centrale, le royaume de Buganda.
[4] Pousses de bamboo fumées, plat traditionnel des Bagisu, un groupe ethnique Bantu qui occupe la région du mont Elgon, dans l’est de l’Ouganda.
[5] Un plat dans lequel les aliments sont cuits dans la sauce
[6] Jus de banane
[7] Une crêpe ougandaise à base de farine de manioc, de bananes desserts mûres et d’une pincée de bicarbonate de soude.
[8] Un groupe ethnique Bantu en Ouganda de l’Ouest
[9] Une purée d’arachides et de sésame avec de la sauce aux légumes
[10] Sauce de beurre clarifié
[11] C’est ainsi que les femmes cultivent
[12] Pluriel de kikapu
[13] Feuilles de bananier


Fwd: E-mail (Renvoi) – Par Brogan Aaron Mwesigwa, Sandra Knecht
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knech
Mercredi 13 août, 13h35
Chère Sandra,
J’espère que tu vas bien. Enchanté de faire ta connaissance par e-mail.
Pour répondre à la question,
J’ai remarqué pour la première fois cette relation à travers ma recherche sur la nourriture ougandaise traditionnelle, lors de mon projet Kumanyagana¹, pour le festival KLA ART. En Ouganda, nos repas sont profondément influencés par les saisons, suivant les plantations et les récoltes. Nous avons deux saisons de plantation, en mars et en août-septembre, et deux saisons de récolte, en juin-juillet et en décembre-janvier. Je me souviens qu’enfant, certaines nourritures faisaient leur apparition au marché à certaines périodes de l’année : par exemple, les nombreux camions remplis de Matooke au marché de Nakulabye présents en juin et décembre. La Matooke² est une des cultures vivrières les plus importantes d’Ouganda.
Je n’ai pas grandi dans une ferme ni participé à des activités de culture sur le long terme, à part m’occuper des poules de ma tante pendant les vacances de 2013. J’ai été élevé dans la jungle de béton de Kampala, la capitale de l’Ouganda, où nous sommes principalement des consommateur·ices et non des producteur·ices. Heureusement, lors de quelques-unes de mes visites au village, j’ai pu voir ma grand-mère observer les nuages et certaines conditions météo pour savoir quand la pluie allait tomber. À l’heure où j’écris, ces signes sont devenus moins fiables. Je lui ai parlé il y a peu et elle m’a confié ne pas avoir eu une goutte de pluie depuis plus de six mois. Le réchauffement climatique a changé les saisons. Parfois, elles arrivent trop tard ou trop fort ou pas du tout. Les saisons de plantation, la disponibilité de nourriture et, dans une large mesure, les rassemblements communautaires liés aux saisons de récolte ont été perturbés.
Au plaisir de lire tes réflexions,
Bien à toi, Brogan.
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Samedi 23 août, 13h1
Cher Brogan,
Désolée pour ma réponse tardive. J’ai eu un accident entre temps, mais tout va bien maintenant. Je t’écris pour te raconter comment j’ai grandi dans les années 70 et 80.
Enfant, le réchauffement climatique n’existait pas encore dans le sens d’aujourd’hui. Tout paraissait possible, tout paraissait atteignable si on s’en donnait les moyens. Le racisme et le classisme n’étaient pas un sujet dans la société dans laquelle j’ai grandi. Tout comme la destruction des ressources naturelles. La famine avait lieu autre part, à Biafra, par exemple. Nelson Mandela et Mahatma Gandhi étaient des modèles, mais qui étaient loin. Il n’y avait pas de numérisation, pas d’internet, nous téléphonions avec un téléphone mural à cadran. En conséquence, nous dépendions de ce qui était écrit dans les livres et ce qu’on nous disait sur le monde extérieur dans les journaux et à la télévision.
J’ai grandi dans un petit village à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, entourée par les vaches. Chaque jour, j’allais à l’école en vélo dans la ville la plus proche. Au déjeuner, je remontais la montagne pour rentrer puis descendais vers la vallée. Je détestais l’école. Je voulais conquérir le monde à dos de cheval. Je faisais du vélo sur des centaines de kilomètres dans la région montagneuse de mon pays : c’était mon moyen de transport. Je passais trois heures par jour à cheval, galopant à travers les forêts et les prairies.
J’ai commencé à travailler très tôt. Ma famille était pauvre. À 13 ans, j’aidais à la boucherie du village et travaillais pour des fermier·e de la montagne pendant les vacances scolaires. C’est à ce moment-là que j’ai appris à cuisiner des plats traditionnels, comme le Rösti³, le pain, les pâtes maison, etc. Les célèbres Älplermaggaronen⁴ avec de la compote de pommes et de la salade étaient très répandues et j’aime toujours autant ce plat aujourd’hui. Pour moi, cela fait partie de la tradition, tout autant que la lutte, le yodel ou l’accordéon.
Notre nourriture dépendait et dépend toujours du lieu où nous l’achetons et de ce que nous faisons pousser. Je mange presque exclusivement de la viande de nos propres animaux, c’est-à-dire du coq et du bélier. En été, je mange les légumes qui poussent dans notre jardin.

Photo: Sandra Knecht
Je suis allée au Mexique il y a un an et, depuis, je mange davantage de maïs, d’ananas et d’avocats. Même si je sais que ces deux fruits sont mauvais pour l’environnement et pour les réserves d’eau lors de leur culture, j’en achète environ une fois par mois. J’ai beaucoup aimé en apprendre plus sur la culture mexicaine, que je ne connaissais pas du tout auparavant. Depuis, j’apprécie beaucoup voyager même si je suis plus vieille maintenant et que je ne parle pas bien d’autres langues.
J’espère que tu vas bien. Meilleures salutations, Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 25 août, 17h49
Chère Sandra,
Je vais bien, merci. Je suis navré que tu aies eu un accident, mais je suis heureux de savoir que tu vas bien.
Contrairement aux années 70 et 90, mes propres souvenirs commencent au début des années 2000. J’ai grandi à Bukesa, un quartier de Kampala, dans une maison modeste où nous avions juste assez pour survivre. C’était une zone en développement avec des appartements se dressant au-dessus de nous et de nombreux bungalows regroupés en ruelles. Quelques familles, qui étaient propriétaires de leur maison, avaient des petits lopins de terre où elles faisaient surtout pousser des matooke et des légumes. Nous en avons planté un peu devant la maison. Pendant les vacances scolaires, j’adorais planter les cannes à sucre. Elles poussaient si rapidement que j’avais du mal à attendre et que je les récoltais dès que les premières tiges sortaient de terre. Faire du cheval est un de mes rêves.

Plantation de maïs après récolte, Photo : Brogan Mwesigwa
Étant un enfant de la ville, me rendre au village semblait toujours être une aventure. J’avais le droit d’aller dans le jardin, mais en tant qu’« invité » d’honneur, je n’étais pas obligé de bêcher et de planter. Pourtant, je me souviens d’avoir planté un arbre avec mes cousins. La dernière fois que je l’ai vu, il effleurait les cieux. Malheureusement, nous avons abandonné cette maison.
Bukesa était aussi un mélange de plusieurs cultures. Il y avait dans notre quartier des personnes de toute l’Afrique de l’Est et des familles indiennes d’Asie. Leurs magasins étaient toujours remplis d’épices et de céréales. Les Ougandais·es s’adaptent vite à de nouvelles cultures, sauf en ce qu’il s’agit de nourriture. C’est pourquoi j’ai goûté pour la première fois à des plats étrangers en rendant visite à mes ami·es érythréen·nes et indien·nes, qui adorent le piment ! J’ai beaucoup apprécié l’Injera, le pain plat traditionnel d’Éthiopie et d’Érythrée, fait avec de la farine de teff. Il est un peu spongieux et a un goût légèrement acide. Il est mangé avec toutes sortes de ragoûts, celui aux haricots étant mon préféré.
En parlant de préféré, mon plat favori est du riz (n’importe quelle sorte) et du ragoût de haricots, un plat que je sais très bien préparer. La cuisine fait partie intégrante de nombreux foyers en Ouganda. La majorité cuisine ses propres plats et les étals de marché proposent divers aliments naturels, comme les Matooke, le riz, la farine de maïs, le manioc, les ignames, de pommes de terre, de patates douces, de courges et de beaucoup de fruits comme les ananas, les oranges, les avocats (j’adore les avocats et j’en mange souvent dans la semaine), les fruits du jacquier, les mangues et bien plus encore. Tout ceci peut se trouver partout dans le pays, mais, pour répondre à une demande croissante, certains aliments sont importés de nos pays voisins, comme le Kenya et la Tanzanie.
Bukesa avait si peu d’arbres que, lorsqu’il faisait chaud, la chaleur pouvait être insupportable. En 2009, à 12 ans, nous avons dû partir à cause de la gentrification qui a balayé l’endroit que j’appelais mon chez-moi.
Je n’ai pas beaucoup voyagé, mais mon récent voyage au Kenya a été l’occasion pour moi de manger beaucoup d’Ugali⁵ . Ça a un goût très différent de celle qu’on trouve en Ouganda. Tout n’est pas mélangé avec le ragoût dans la même assiette, alors qu’ici, nous le faisons avec tout notre cœur.
Peux-tu me raconter ton expérience de fonctionnaire, travaillant avec des réfugié·es pendant 20 ans ?
Quand as-tu découvert que tu étais une artiste ? Quand tu étais jeune ou des années plus tard ?
Amicalement, Brogan
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Jeudi 4 septembre, 13h34
C’est intéressant que tu n’aies pas beaucoup voyagé non plus. De mon côté, j’ai commencé à le faire récemment pour des expositions artistiques et des résidences. Mais, comme j’ai des animaux et un jardin, c’est difficile de trouver quelqu’un qui peut s’en occuper correctement quand je suis absente.

Photo: Sandra Knecht
J’ai vécu avec des personnes éthiopiennes une fois. C’est pourquoi je mange beaucoup de nourriture traditionnelle de là-bas. J’adore les légumineuses, le riz et l’injera. J’adore manger avec mes mains et tremper le pain dans les sauces. La cuillère est mon couvert préféré. Je cuisine souvent, donc c’est la seule chose dont j’ai besoin pour manger.
Depuis que je suis allée au Mexique, je mange bien plus de fruits tropicaux différents, tels que les ananas, les bananes, la mangue et les avocats. C’est bon pour mon corps. Mais je me sens aussi coupable pour le climat, donc je réduis un peu. Nous avons aussi de très bons fruits ici, comme les prunes, les cerises, les pommes, les poires et toutes sortes de baies.
Je mange autant de plantes différentes que possible, au moins 33 par semaine. Des céréales, des haricots, des herbes et actuellement beaucoup de tomatilles, tomates, concombres, courgettes et divers légumes verts du jardin. Chaque jour, nous mangeons des sauces et du pain fait maison avec des œufs de nos poules. Selon moi, cette abondance vaut bien les difficultés liées à la vie à la campagne.
Je suis souvent allée dans de grandes villes ces dernières années et j’ai toujours été submergée et surstimulée. La plupart du temps, je suis seule chez moi et je ne vois pas et ne parle pas à beaucoup de gens. Quand je suis en ville, j’absorbe tout ce que je rencontre, en particulier aux marchés, où j’ai la chance d’apprendre à connaître la culture locale.
J’aimerais beaucoup voyager dans le sud de l’Afrique. Je ne suis allée que dans le nord : Maroc, Algérie et Tunisie. Comme je ne supporte pas bien la chaleur, je ne suis pas sûre qu’il y ait une période où la température se trouve en dessous de 30 degrés Celsius.
La nourriture africaine est ce que je connais le moins. Il y a tant de pays et cultures différentes sur cet énorme continent. Je cuisine beaucoup avec du sumac. Une amie à moi qui vit au Mali m’en apporte toujours de son village. Sa saveur chocolatée et fermentée donne de la profondeur aux plats qui doivent mijoter longtemps. Je pense que c’est dommage que cette épice merveilleuse soit progressivement remplacée par le Maggi⁶. Je m’intéresse beaucoup à la gentrification du goût par des sociétés comme Nestlé. C’est une forme de colonisation qui vole l’identité des gens et les rend dépendants de sociétés qui dévorent tout ce qu’elles peuvent se procurer.
Je n’ai jamais mangé de matooke. J’adore les ignames et le manioc. Ça me rappelle les légumes racines, tels que nos panais, qui sont cependant plus neutres et ont une consistance tout à fait différente. Je pourrais manger du porridge au goût neutre et des ragoûts épicés et pimentés tous les jours.
Tu manges de la viande ? Si oui, quel type ? Comment la prépares-tu ?
Enfant, j’adorais les musées. Ma mère a dû m’y emmener très tôt. J’avais 8 ans quand j’ai rendu visite aux vieux maîtres dans un musée de Zurich. Je pense que j’aurais aimé faire de l’art jeune. Mais je n’ai jamais été encouragée à le faire. Donc j’ai travaillé avec des personnes réfugiées de Somalie, du Liban, du Brésil, d’Iran, d’Afghanistan, etc. J’ai cuisiné avec eux et parlé des vies qu’elles avaient avant d’être emmenées ici en Suisse.
J’ai remarqué que les personnes venant de la campagne avaient de grandes difficultés à s’adapter à la vie citadine et que les personnes venant de la ville ne comprenaient pas du tout la campagne et ses mœurs. J’en ai donc fait une particularité de mon travail. Après ça, j’ai pu créer bien plus de connexion en me concentrant sur leur cuisine et leur musique. Je pense que ça faciliterait les choses si les personnes de la campagne pouvaient vivre à la campagne et celles de la ville en ville. Le choc en serait moins grand, déjà.
Bien cordialement, Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 8 septembre, 18h28
Chère Sandra,
Ici, en Ouganda, ce qui est intéressant à propos de notre nourriture, c’est que ça prend souvent beaucoup de temps à cuisiner. Le processus traditionnel est encore plus lent. Les aliments sont souvent enveloppés dans des feuilles de banane puis laissés à mijoter pendant des heures, donnant lieu à des plats onctueux et pleins de saveur. En parlant de gentrification du goût : les chaînes de fast food prennent le contrôle ici, en particulier dans les zones urbaines où les jeunes semblent détester faire la cuisine. La forte demande en poulet fait que nous mangeons souvent des poussins de trois semaines. C’est pourquoi je préfère les poulets locaux, élevés en plein air, qui sont désormais très chers. J’en mange moins maintenant.

Matooke pelées, Photo : Brogan Mwesigwa
Tu devrais goûter les matooke un jour. C’est encore meilleur avec de la purée d’arachides. Je mange diverses viandes : du bœuf, du porc, du poulet et de la chèvre. J’ai déjà goûté du mouton, mais je n’ai jamais mangé de lapin. Pour moi, ils sont trop mignons pour pouvoir les manger. Quand je prépare de la viande, je commence par la faire rôtir sur le feu avec des peaux de banane pour plus de saveurs. Je la fais ensuite cuire à l’eau quelques minutes, l’égoutte, puis la laisse un peu sécher. Ensuite, je la fais cuire avec de l’huile de cuisson végétale et des oignons, puis j’ajoute des tomates, des carottes, de l’ail et du poivron vert à feu vif. Une fois que tout est tendre, j’ajoute des épices, comme du poivre noir, du paprika et du curcuma, puis de l’eau. Je laisse bouillir pendant 15 minutes, j’ajoute de l’épaississant comme du Royco⁷ et du sel, puis laisse mijoter pour encore 20 minutes. Le résultat est un pot-au-feu épais. Tu parles de beaucoup de nourriture à base de plantes : tu es végétarienne ?
Quel type de porridge aimes-tu manger ? J’aime le mélange de flocons d’avoine, de farine de soja et de lait, en général avec une crêpe à base de farine de blé, de bananes et avec deux œufs, que je mange au petit déjeuner trois fois par semaine. J’adore manger du « Rolex », mais pas la montre ! C’est comme une omelette roulée dans un chapati, un pain plat, moelleux, fin et rond fait de farine de blé, d’eau et un peu d’huile. C’est croustillant sur le dessus. J’aime manger ça avec des tomates crues, du chou, des oignons et de l’avocat. Fun fact : le nom vient de « rolled eggs » (œufs roulés), qui est vite devenu « Rolex »
Je n’ai jamais visité de musée d’art pour l’instant, mais j’adorerais voir les œuvres des maîtres en personne. Claude Monet, Auguste Renoir, Rembrandt, sans oublier Michelangelo et mon préféré, William-Adolphe Bouguereau.
Il y a peu, j’ai animé un atelier avec des réfugié·es congolais·es. Nous avons mangé des Sombe, Ugali, et Kwanga, des aliments traditionnels congolais, et avons parlé de leurs vies en Ouganda et comment iels sont venu·es ici. Je vis dans une petite ville en dehors de la ville Kampala. Il y a une décennie, c’était un village, mais son identité a changé avec le développement urbain, les migrations et les transitions sociales. Il y a beaucoup de constructions, car la ville s’étend, et certaines de ces transformations sont devenues un symbole clé de mes peintures, qui explorent comment les humains et la nature se fraient un chemin à travers ces changements.
Puisque tu vis à la campagne, de quelle manière le paysage influence-t-il ta pratique artistique et l’exploration de sujets écologiques ?
Plus vieux, j’aimerais vivre à la campagne. Je pense au district de Kisoro dans la région de Kigezi, souvent appelé « la Suisse de l’Ouganda ». Les paysages sont beaux et sauvages, avec des collines verdoyantes et des champs en terrasse comparables à ceux de Suisse, et j’aimerais beaucoup y être agriculteur.
Amitiés, Brogan
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Mardi 30 septembre, 15h34
Cher Brogan,
Je suis vraiment désolée. Je vais bien maintenant, merci de t’en être inquiété.
En Suisse, nous avons aussi des petites maisons avec des jardins et de petites écuries. Dans le passé, c’était les maisons des familles des ouvrier·es. J’ai grandi dans une maison comme celles-ci. Je devais toujours aider au jardin, ce que je n’aimais pas tellement quand j’étais jeune.
Je n’ai jamais mangé de sucre venant directement de la canne à sucre. Le goût doit sûrement être très différent des morceaux de sucre achetés au supermarché.
Certains rêves doivent se réaliser et d’autres doivent rester des rêves, car ils sont bien plus beaux que la réalité.
Pourquoi as-tu dû quitter la maison avec l’arbre que vous aviez planté ?
J’ai vécu avec des personnes éthiopiennes quand j’étais jeune. Elles cuisinaient au moins deux fois par semaine, et elles servaient toujours ce superbe pain à base de farine de teff. J’aime beaucoup manger avec les mains. Mon couvert préféré est la cuillère. J’adore les ragoûts, les légumes, les haricots et le riz. Ils peuvent tous très bien se manger à la cuillère.
Cuisiner est aussi essentiel pour moi. Je le fais tous les jours. J’adore les nombreux types différents de légumes, mais aussi la viande et le poisson. J’aimerais en savoir plus sur la cuisson des ignames, du manioc et du fruit de jacquier. Je ne connais que le goût de l’igname, car j’en ai déjà fait des chips et ça pousse aussi ici.

Photo: Sandra Knecht
Pour moi, travailler avec des personnes réfugiées et des jeunes toxicomanes a été très intéressant et exigeant. J’ai beaucoup aimé être en contact avec tant de cultures et familles différentes, apprenant d’eux et les accompagnant.
J’ai commencé à faire de l’art très tard dans ma vie. Je n’avais pas prévu de devenir artiste. Quand le Printemps arabe a commencé en 2010-2011, j’ai voulu faire une pause et j’ai décidé d’apprendre quelque chose que je connaissais peu, mais qui m’intéressait. C’est ainsi que j’ai fini par faire un master en art. C’est resté ainsi. Mais je ne suis pas sûre que le marché de l’art soit bon pour ma santé mentale. La pression est énorme, en particulier car j’en vis et que je n’ai pas d’autre travail. Comment fais-tu pour gérer ça ?
Bien à toi. Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Mercredi 1er octobre, 15h13
Chère Sandra,
Bonjour ! J’espère qu’octobre a bien commencé pour toi.
La canne à sucre utilisée pour faire du sucre est bien différente de celle utilisée pour faire du jus et des encas. Elle est plus fine et dure. Les plantations de canne à sucre à des fins commerciales ont une triste histoire, car elles ont pour conséquence le déplacement de communautés et la déforestation à grande échelle. Nous avons plusieurs variétés. Je préfère la Goa. Elle est vert clair, souple et plutôt rare en ce moment.
J’ai planté un arbre à la maison, un faux ashoka, mais il a des difficultés à cause des changements de climat. Kamuli, à l’est de l’Ouganda, a subi de longues périodes de sécheresse, ce qui a eu de grandes conséquences sur l’agriculture. La terre est sèche et les cultures de haricots, maïs, arachides et patates douces ont eu très peu de rendement.
Je n’ai commencé à cuisiner qu’à l’âge adulte. En grandissant, c’était considéré comme un travail féminin, alors que les garçons comme moi avions des tâches plus intenses, notamment aller chercher de l’eau du puits à 400 mètres, faire la vaisselle ou tout ce qui demandait plus d’effort physique.
J’adore ce que tu as dit sur les rêves. Je suis entièrement d’accord. C’était quoi ton rêve, quand tu étais enfant ?
D’ailleurs, le fruit du jacquier est appelé Ffene ici, et c’est un dessert populaire. Je me souviens, quand j’étais en primaire, autour de mes 8 ans, l’enceinte de notre école avait énormément de jacquiers. Quand c’était la saison, nous montions aux arbres et mangions les fruits en secret, car c’était interdit. Mais nous étions des enfants têtu·es, et c’était la même histoire pour les carottes et concombres. Ça nous a causé beaucoup de problèmes !
De mon côté, j’ai toujours voulu être un artiste, depuis environ 2011, quand tu essayais aussi de nouvelles choses. Un·e professeur·e d’art m’avait dit qu’il était possible de faire une carrière dans l’art, ce que je ne savais pas avant. Je n’ai jamais remis en question ce choix. Le monde de l’art vient avec ses pressions, mais, en tant qu’artiste émergent, je me concentre sur mon évolution personnelle plutôt que sur le succès prématuré. Le succès, qu’est-ce que c’est, d’ailleurs ? Selon moi, il s’agit seulement d’avoir la paix et la sécurité pour continuer à faire de l’art. Ma foi me permet de garder la tête froide.
Et toi ? Comment définirais-tu le succès pour un·e artiste ?
Travailler avec des personnes réfugiées m’a aussi beaucoup aidé. Ça m’a insufflé de l’empathie et de la compassion envers les populations déplacées, en particulier celles forcées de quitter leur maison. En écoutant leurs histoires, je me suis rendu compte de la fragilité de la vie. Aujourd’hui, ce sont elles, demain, cela pourrait être moi. Partager des repas avec ces personnes m’a fait apprécier la façon dont la nourriture est porteuse de mémoire et à quel point la culture y est liée.
J’adore les chiens. Tu as des animaux de compagnie ?
Amicalement, Brogan
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Lundi 13 octobre, 15h19
Cher Brogan,
Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. J’espère que tu vas bien. Je serai ravie que tu puisses visiter la Suisse un jour.
Dans deux jours, je voyagerai vers Berlin avec mes deux petits chiens pour travailler pour l’avenir. Je n’aurai donc pas le temps de te répondre avant décembre.
Quoi qu’il en soit, je te souhaite tout de bon et beaucoup de succès dans tous tes projets.
Bien à toi ! Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 13 octobre, 17h49
Chère Sandra,
Je vais bien, merci. J’espère que toi aussi.
Je viendrai en Suisse un jour. Je suis ravi de te connaître et de voir ta pratique, et je te souhaite un bon voyage vers Berlin.
Bonjour à tes deux petits chiens. Je te souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès aussi. Je suis impatient de voir la publication.
Cordialement, Brogan
Brogan Aaron Mwesigwa (UG) (1997, Jinja) est un peintre ougandais dont le travail étudie la vie en Afrique postcoloniale à travers l’expression figurative et la pratique participative. Il peint principalement à l’huile sur du papier recyclé. Il transforme ainsi des rebuts de papiers en des surfaces expressives portant les histoires de mémoire, d’identité, de transformation et de communauté. Il mêle dans ses compositions l’imagination à l’observation aigüe de la société pour créer des allégories calmes, mais profondes des expériences contemporaines.
Dans le projet participatif de Brogan Aaron Mwesigwa, Kumanyagana, ces sujets sont approfondis au sein de la sphère sociale. Il s’appuie sur les traditions ougandaises d’hospitalité et de partage de la nourriture et explore les rassemblements communautaires en tant que sujet et méthode.
Il a une licence en arts industriels et beaux-arts de l’université Makerere. Ses œuvres ont été exposées lors d’évènements comme le KLA ART ‘24, l’Art Salon 2021, l’East African Artist Connect 2021 (2ème édition), et à sa première exposition en solo en 2021. Il était demi-finaliste des prix Tilga Art Fund et Mukumbya Musoke Art Prize. Son travail a été mis en avant dans The Guardian.
@broganmwesigwa
Sandra Knecht (CH) (1968, Zurich) possède un Master en beaux-arts de l’université des Arts de Zurich (ZHdK). La cuisine est l’élément central de sa pratique artistique. Avec ses évènements et installations culinaires, elle a participé à diverses biennales et a exposé dans des musées d’arts en Suisse et à l’étranger, notamment au KBH, à la fondation culturelle de Bâle H. Geiger, au Basel Social Club, à la Biennale de Venise, à la Fondation Joan Miró Museum de Barcelone, au Musée Tinguely de Bâle, à la Kunsthaus de Zurich, au Kunstmuseum de Bâle, à la Kunsthaus Baselland, au FRAC Alsace, à l’Industrial Art Biennial en Croatie et au festival international du film de Locarno. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Swiss Art Award 2022, la bourse Basel Work Grant en 2015 et 2023, le Werkbund Label Baden-Württemberg en 2016 et l’ADC Award en 2017.
https://www.sandraknecht.ch/
@chnaechtspaecht
[1] Apprendre à se connaître
[2] Une variété de banane populaire en Afrique de l’Est
[3] Un plat à base de pommes de terre en forme de pancake/crêpe
[4] Un ragoût fait de pâtes, pommes de terre, oignons, restes de viande, saucisse, crème et fromage
[5] Farine de maïs bouillie
[6] Un mélange d’épices suisse
[7] Un mélange d’épices est africain

Fwd: E-mail (Renvoi) – Par Brogan Aaron Mwesigwa, Sandra Knecht
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knech
Mercredi 13 août, 13h35
Chère Sandra,
J’espère que tu vas bien. Enchanté de faire ta connaissance par e-mail.
Pour répondre à la question,
J’ai remarqué pour la première fois cette relation à travers ma recherche sur la nourriture ougandaise traditionnelle, lors de mon projet Kumanyagana¹, pour le festival KLA ART. En Ouganda, nos repas sont profondément influencés par les saisons, suivant les plantations et les récoltes. Nous avons deux saisons de plantation, en mars et en août-septembre, et deux saisons de récolte, en juin-juillet et en décembre-janvier. Je me souviens qu’enfant, certaines nourritures faisaient leur apparition au marché à certaines périodes de l’année : par exemple, les nombreux camions remplis de Matooke au marché de Nakulabye présents en juin et décembre. La Matooke² est une des cultures vivrières les plus importantes d’Ouganda.
Je n’ai pas grandi dans une ferme ni participé à des activités de culture sur le long terme, à part m’occuper des poules de ma tante pendant les vacances de 2013. J’ai été élevé dans la jungle de béton de Kampala, la capitale de l’Ouganda, où nous sommes principalement des consommateur·ices et non des producteur·ices. Heureusement, lors de quelques-unes de mes visites au village, j’ai pu voir ma grand-mère observer les nuages et certaines conditions météo pour savoir quand la pluie allait tomber. À l’heure où j’écris, ces signes sont devenus moins fiables. Je lui ai parlé il y a peu et elle m’a confié ne pas avoir eu une goutte de pluie depuis plus de six mois. Le réchauffement climatique a changé les saisons. Parfois, elles arrivent trop tard ou trop fort ou pas du tout. Les saisons de plantation, la disponibilité de nourriture et, dans une large mesure, les rassemblements communautaires liés aux saisons de récolte ont été perturbés.
Au plaisir de lire tes réflexions,
Bien à toi, Brogan.
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Samedi 23 août, 13h1
Cher Brogan,
Désolée pour ma réponse tardive. J’ai eu un accident entre temps, mais tout va bien maintenant. Je t’écris pour te raconter comment j’ai grandi dans les années 70 et 80.
Enfant, le réchauffement climatique n’existait pas encore dans le sens d’aujourd’hui. Tout paraissait possible, tout paraissait atteignable si on s’en donnait les moyens. Le racisme et le classisme n’étaient pas un sujet dans la société dans laquelle j’ai grandi. Tout comme la destruction des ressources naturelles. La famine avait lieu autre part, à Biafra, par exemple. Nelson Mandela et Mahatma Gandhi étaient des modèles, mais qui étaient loin. Il n’y avait pas de numérisation, pas d’internet, nous téléphonions avec un téléphone mural à cadran. En conséquence, nous dépendions de ce qui était écrit dans les livres et ce qu’on nous disait sur le monde extérieur dans les journaux et à la télévision.
J’ai grandi dans un petit village à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, entourée par les vaches. Chaque jour, j’allais à l’école en vélo dans la ville la plus proche. Au déjeuner, je remontais la montagne pour rentrer puis descendais vers la vallée. Je détestais l’école. Je voulais conquérir le monde à dos de cheval. Je faisais du vélo sur des centaines de kilomètres dans la région montagneuse de mon pays : c’était mon moyen de transport. Je passais trois heures par jour à cheval, galopant à travers les forêts et les prairies.
J’ai commencé à travailler très tôt. Ma famille était pauvre. À 13 ans, j’aidais à la boucherie du village et travaillais pour des fermier·e de la montagne pendant les vacances scolaires. C’est à ce moment-là que j’ai appris à cuisiner des plats traditionnels, comme le Rösti³, le pain, les pâtes maison, etc. Les célèbres Älplermaggaronen⁴ avec de la compote de pommes et de la salade étaient très répandues et j’aime toujours autant ce plat aujourd’hui. Pour moi, cela fait partie de la tradition, tout autant que la lutte, le yodel ou l’accordéon.
Notre nourriture dépendait et dépend toujours du lieu où nous l’achetons et de ce que nous faisons pousser. Je mange presque exclusivement de la viande de nos propres animaux, c’est-à-dire du coq et du bélier. En été, je mange les légumes qui poussent dans notre jardin.

Photo: Sandra Knecht
Je suis allée au Mexique il y a un an et, depuis, je mange davantage de maïs, d’ananas et d’avocats. Même si je sais que ces deux fruits sont mauvais pour l’environnement et pour les réserves d’eau lors de leur culture, j’en achète environ une fois par mois. J’ai beaucoup aimé en apprendre plus sur la culture mexicaine, que je ne connaissais pas du tout auparavant. Depuis, j’apprécie beaucoup voyager même si je suis plus vieille maintenant et que je ne parle pas bien d’autres langues.
J’espère que tu vas bien. Meilleures salutations, Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 25 août, 17h49
Chère Sandra,
Je vais bien, merci. Je suis navré que tu aies eu un accident, mais je suis heureux de savoir que tu vas bien.
Contrairement aux années 70 et 90, mes propres souvenirs commencent au début des années 2000. J’ai grandi à Bukesa, un quartier de Kampala, dans une maison modeste où nous avions juste assez pour survivre. C’était une zone en développement avec des appartements se dressant au-dessus de nous et de nombreux bungalows regroupés en ruelles. Quelques familles, qui étaient propriétaires de leur maison, avaient des petits lopins de terre où elles faisaient surtout pousser des matooke et des légumes. Nous en avons planté un peu devant la maison. Pendant les vacances scolaires, j’adorais planter les cannes à sucre. Elles poussaient si rapidement que j’avais du mal à attendre et que je les récoltais dès que les premières tiges sortaient de terre. Faire du cheval est un de mes rêves.

Plantation de maïs après récolte, Photo : Brogan Mwesigwa
Étant un enfant de la ville, me rendre au village semblait toujours être une aventure. J’avais le droit d’aller dans le jardin, mais en tant qu’« invité » d’honneur, je n’étais pas obligé de bêcher et de planter. Pourtant, je me souviens d’avoir planté un arbre avec mes cousins. La dernière fois que je l’ai vu, il effleurait les cieux. Malheureusement, nous avons abandonné cette maison.
Bukesa était aussi un mélange de plusieurs cultures. Il y avait dans notre quartier des personnes de toute l’Afrique de l’Est et des familles indiennes d’Asie. Leurs magasins étaient toujours remplis d’épices et de céréales. Les Ougandais·es s’adaptent vite à de nouvelles cultures, sauf en ce qu’il s’agit de nourriture. C’est pourquoi j’ai goûté pour la première fois à des plats étrangers en rendant visite à mes ami·es érythréen·nes et indien·nes, qui adorent le piment ! J’ai beaucoup apprécié l’Injera, le pain plat traditionnel d’Éthiopie et d’Érythrée, fait avec de la farine de teff. Il est un peu spongieux et a un goût légèrement acide. Il est mangé avec toutes sortes de ragoûts, celui aux haricots étant mon préféré.
En parlant de préféré, mon plat favori est du riz (n’importe quelle sorte) et du ragoût de haricots, un plat que je sais très bien préparer. La cuisine fait partie intégrante de nombreux foyers en Ouganda. La majorité cuisine ses propres plats et les étals de marché proposent divers aliments naturels, comme les Matooke, le riz, la farine de maïs, le manioc, les ignames, de pommes de terre, de patates douces, de courges et de beaucoup de fruits comme les ananas, les oranges, les avocats (j’adore les avocats et j’en mange souvent dans la semaine), les fruits du jacquier, les mangues et bien plus encore. Tout ceci peut se trouver partout dans le pays, mais, pour répondre à une demande croissante, certains aliments sont importés de nos pays voisins, comme le Kenya et la Tanzanie.
Bukesa avait si peu d’arbres que, lorsqu’il faisait chaud, la chaleur pouvait être insupportable. En 2009, à 12 ans, nous avons dû partir à cause de la gentrification qui a balayé l’endroit que j’appelais mon chez-moi.
Je n’ai pas beaucoup voyagé, mais mon récent voyage au Kenya a été l’occasion pour moi de manger beaucoup d’Ugali⁵ . Ça a un goût très différent de celle qu’on trouve en Ouganda. Tout n’est pas mélangé avec le ragoût dans la même assiette, alors qu’ici, nous le faisons avec tout notre cœur.
Peux-tu me raconter ton expérience de fonctionnaire, travaillant avec des réfugié·es pendant 20 ans ?
Quand as-tu découvert que tu étais une artiste ? Quand tu étais jeune ou des années plus tard ?
Amicalement, Brogan
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Jeudi 4 septembre, 13h34
C’est intéressant que tu n’aies pas beaucoup voyagé non plus. De mon côté, j’ai commencé à le faire récemment pour des expositions artistiques et des résidences. Mais, comme j’ai des animaux et un jardin, c’est difficile de trouver quelqu’un qui peut s’en occuper correctement quand je suis absente.

Photo: Sandra Knecht
J’ai vécu avec des personnes éthiopiennes une fois. C’est pourquoi je mange beaucoup de nourriture traditionnelle de là-bas. J’adore les légumineuses, le riz et l’injera. J’adore manger avec mes mains et tremper le pain dans les sauces. La cuillère est mon couvert préféré. Je cuisine souvent, donc c’est la seule chose dont j’ai besoin pour manger.
Depuis que je suis allée au Mexique, je mange bien plus de fruits tropicaux différents, tels que les ananas, les bananes, la mangue et les avocats. C’est bon pour mon corps. Mais je me sens aussi coupable pour le climat, donc je réduis un peu. Nous avons aussi de très bons fruits ici, comme les prunes, les cerises, les pommes, les poires et toutes sortes de baies.
Je mange autant de plantes différentes que possible, au moins 33 par semaine. Des céréales, des haricots, des herbes et actuellement beaucoup de tomatilles, tomates, concombres, courgettes et divers légumes verts du jardin. Chaque jour, nous mangeons des sauces et du pain fait maison avec des œufs de nos poules. Selon moi, cette abondance vaut bien les difficultés liées à la vie à la campagne.
Je suis souvent allée dans de grandes villes ces dernières années et j’ai toujours été submergée et surstimulée. La plupart du temps, je suis seule chez moi et je ne vois pas et ne parle pas à beaucoup de gens. Quand je suis en ville, j’absorbe tout ce que je rencontre, en particulier aux marchés, où j’ai la chance d’apprendre à connaître la culture locale.
J’aimerais beaucoup voyager dans le sud de l’Afrique. Je ne suis allée que dans le nord : Maroc, Algérie et Tunisie. Comme je ne supporte pas bien la chaleur, je ne suis pas sûre qu’il y ait une période où la température se trouve en dessous de 30 degrés Celsius.
La nourriture africaine est ce que je connais le moins. Il y a tant de pays et cultures différentes sur cet énorme continent. Je cuisine beaucoup avec du sumac. Une amie à moi qui vit au Mali m’en apporte toujours de son village. Sa saveur chocolatée et fermentée donne de la profondeur aux plats qui doivent mijoter longtemps. Je pense que c’est dommage que cette épice merveilleuse soit progressivement remplacée par le Maggi⁶. Je m’intéresse beaucoup à la gentrification du goût par des sociétés comme Nestlé. C’est une forme de colonisation qui vole l’identité des gens et les rend dépendants de sociétés qui dévorent tout ce qu’elles peuvent se procurer.
Je n’ai jamais mangé de matooke. J’adore les ignames et le manioc. Ça me rappelle les légumes racines, tels que nos panais, qui sont cependant plus neutres et ont une consistance tout à fait différente. Je pourrais manger du porridge au goût neutre et des ragoûts épicés et pimentés tous les jours.
Tu manges de la viande ? Si oui, quel type ? Comment la prépares-tu ?
Enfant, j’adorais les musées. Ma mère a dû m’y emmener très tôt. J’avais 8 ans quand j’ai rendu visite aux vieux maîtres dans un musée de Zurich. Je pense que j’aurais aimé faire de l’art jeune. Mais je n’ai jamais été encouragée à le faire. Donc j’ai travaillé avec des personnes réfugiées de Somalie, du Liban, du Brésil, d’Iran, d’Afghanistan, etc. J’ai cuisiné avec eux et parlé des vies qu’elles avaient avant d’être emmenées ici en Suisse.
J’ai remarqué que les personnes venant de la campagne avaient de grandes difficultés à s’adapter à la vie citadine et que les personnes venant de la ville ne comprenaient pas du tout la campagne et ses mœurs. J’en ai donc fait une particularité de mon travail. Après ça, j’ai pu créer bien plus de connexion en me concentrant sur leur cuisine et leur musique. Je pense que ça faciliterait les choses si les personnes de la campagne pouvaient vivre à la campagne et celles de la ville en ville. Le choc en serait moins grand, déjà.
Bien cordialement, Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 8 septembre, 18h28
Chère Sandra,
Ici, en Ouganda, ce qui est intéressant à propos de notre nourriture, c’est que ça prend souvent beaucoup de temps à cuisiner. Le processus traditionnel est encore plus lent. Les aliments sont souvent enveloppés dans des feuilles de banane puis laissés à mijoter pendant des heures, donnant lieu à des plats onctueux et pleins de saveur. En parlant de gentrification du goût : les chaînes de fast food prennent le contrôle ici, en particulier dans les zones urbaines où les jeunes semblent détester faire la cuisine. La forte demande en poulet fait que nous mangeons souvent des poussins de trois semaines. C’est pourquoi je préfère les poulets locaux, élevés en plein air, qui sont désormais très chers. J’en mange moins maintenant.

Matooke pelées, Photo : Brogan Mwesigwa
Tu devrais goûter les matooke un jour. C’est encore meilleur avec de la purée d’arachides. Je mange diverses viandes : du bœuf, du porc, du poulet et de la chèvre. J’ai déjà goûté du mouton, mais je n’ai jamais mangé de lapin. Pour moi, ils sont trop mignons pour pouvoir les manger. Quand je prépare de la viande, je commence par la faire rôtir sur le feu avec des peaux de banane pour plus de saveurs. Je la fais ensuite cuire à l’eau quelques minutes, l’égoutte, puis la laisse un peu sécher. Ensuite, je la fais cuire avec de l’huile de cuisson végétale et des oignons, puis j’ajoute des tomates, des carottes, de l’ail et du poivron vert à feu vif. Une fois que tout est tendre, j’ajoute des épices, comme du poivre noir, du paprika et du curcuma, puis de l’eau. Je laisse bouillir pendant 15 minutes, j’ajoute de l’épaississant comme du Royco⁷ et du sel, puis laisse mijoter pour encore 20 minutes. Le résultat est un pot-au-feu épais. Tu parles de beaucoup de nourriture à base de plantes : tu es végétarienne ?
Quel type de porridge aimes-tu manger ? J’aime le mélange de flocons d’avoine, de farine de soja et de lait, en général avec une crêpe à base de farine de blé, de bananes et avec deux œufs, que je mange au petit déjeuner trois fois par semaine. J’adore manger du « Rolex », mais pas la montre ! C’est comme une omelette roulée dans un chapati, un pain plat, moelleux, fin et rond fait de farine de blé, d’eau et un peu d’huile. C’est croustillant sur le dessus. J’aime manger ça avec des tomates crues, du chou, des oignons et de l’avocat. Fun fact : le nom vient de « rolled eggs » (œufs roulés), qui est vite devenu « Rolex »
Je n’ai jamais visité de musée d’art pour l’instant, mais j’adorerais voir les œuvres des maîtres en personne. Claude Monet, Auguste Renoir, Rembrandt, sans oublier Michelangelo et mon préféré, William-Adolphe Bouguereau.
Il y a peu, j’ai animé un atelier avec des réfugié·es congolais·es. Nous avons mangé des Sombe, Ugali, et Kwanga, des aliments traditionnels congolais, et avons parlé de leurs vies en Ouganda et comment iels sont venu·es ici. Je vis dans une petite ville en dehors de la ville Kampala. Il y a une décennie, c’était un village, mais son identité a changé avec le développement urbain, les migrations et les transitions sociales. Il y a beaucoup de constructions, car la ville s’étend, et certaines de ces transformations sont devenues un symbole clé de mes peintures, qui explorent comment les humains et la nature se fraient un chemin à travers ces changements.
Puisque tu vis à la campagne, de quelle manière le paysage influence-t-il ta pratique artistique et l’exploration de sujets écologiques ?
Plus vieux, j’aimerais vivre à la campagne. Je pense au district de Kisoro dans la région de Kigezi, souvent appelé « la Suisse de l’Ouganda ». Les paysages sont beaux et sauvages, avec des collines verdoyantes et des champs en terrasse comparables à ceux de Suisse, et j’aimerais beaucoup y être agriculteur.
Amitiés, Brogan
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Mardi 30 septembre, 15h34
Cher Brogan,
Je suis vraiment désolée. Je vais bien maintenant, merci de t’en être inquiété.
En Suisse, nous avons aussi des petites maisons avec des jardins et de petites écuries. Dans le passé, c’était les maisons des familles des ouvrier·es. J’ai grandi dans une maison comme celles-ci. Je devais toujours aider au jardin, ce que je n’aimais pas tellement quand j’étais jeune.
Je n’ai jamais mangé de sucre venant directement de la canne à sucre. Le goût doit sûrement être très différent des morceaux de sucre achetés au supermarché.
Certains rêves doivent se réaliser et d’autres doivent rester des rêves, car ils sont bien plus beaux que la réalité.
Pourquoi as-tu dû quitter la maison avec l’arbre que vous aviez planté ?
J’ai vécu avec des personnes éthiopiennes quand j’étais jeune. Elles cuisinaient au moins deux fois par semaine, et elles servaient toujours ce superbe pain à base de farine de teff. J’aime beaucoup manger avec les mains. Mon couvert préféré est la cuillère. J’adore les ragoûts, les légumes, les haricots et le riz. Ils peuvent tous très bien se manger à la cuillère.
Cuisiner est aussi essentiel pour moi. Je le fais tous les jours. J’adore les nombreux types différents de légumes, mais aussi la viande et le poisson. J’aimerais en savoir plus sur la cuisson des ignames, du manioc et du fruit de jacquier. Je ne connais que le goût de l’igname, car j’en ai déjà fait des chips et ça pousse aussi ici.

Photo: Sandra Knecht
Pour moi, travailler avec des personnes réfugiées et des jeunes toxicomanes a été très intéressant et exigeant. J’ai beaucoup aimé être en contact avec tant de cultures et familles différentes, apprenant d’eux et les accompagnant.
J’ai commencé à faire de l’art très tard dans ma vie. Je n’avais pas prévu de devenir artiste. Quand le Printemps arabe a commencé en 2010-2011, j’ai voulu faire une pause et j’ai décidé d’apprendre quelque chose que je connaissais peu, mais qui m’intéressait. C’est ainsi que j’ai fini par faire un master en art. C’est resté ainsi. Mais je ne suis pas sûre que le marché de l’art soit bon pour ma santé mentale. La pression est énorme, en particulier car j’en vis et que je n’ai pas d’autre travail. Comment fais-tu pour gérer ça ?
Bien à toi. Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Mercredi 1er octobre, 15h13
Chère Sandra,
Bonjour ! J’espère qu’octobre a bien commencé pour toi.
La canne à sucre utilisée pour faire du sucre est bien différente de celle utilisée pour faire du jus et des encas. Elle est plus fine et dure. Les plantations de canne à sucre à des fins commerciales ont une triste histoire, car elles ont pour conséquence le déplacement de communautés et la déforestation à grande échelle. Nous avons plusieurs variétés. Je préfère la Goa. Elle est vert clair, souple et plutôt rare en ce moment.
J’ai planté un arbre à la maison, un faux ashoka, mais il a des difficultés à cause des changements de climat. Kamuli, à l’est de l’Ouganda, a subi de longues périodes de sécheresse, ce qui a eu de grandes conséquences sur l’agriculture. La terre est sèche et les cultures de haricots, maïs, arachides et patates douces ont eu très peu de rendement.
Je n’ai commencé à cuisiner qu’à l’âge adulte. En grandissant, c’était considéré comme un travail féminin, alors que les garçons comme moi avions des tâches plus intenses, notamment aller chercher de l’eau du puits à 400 mètres, faire la vaisselle ou tout ce qui demandait plus d’effort physique.
J’adore ce que tu as dit sur les rêves. Je suis entièrement d’accord. C’était quoi ton rêve, quand tu étais enfant ?
D’ailleurs, le fruit du jacquier est appelé Ffene ici, et c’est un dessert populaire. Je me souviens, quand j’étais en primaire, autour de mes 8 ans, l’enceinte de notre école avait énormément de jacquiers. Quand c’était la saison, nous montions aux arbres et mangions les fruits en secret, car c’était interdit. Mais nous étions des enfants têtu·es, et c’était la même histoire pour les carottes et concombres. Ça nous a causé beaucoup de problèmes !
De mon côté, j’ai toujours voulu être un artiste, depuis environ 2011, quand tu essayais aussi de nouvelles choses. Un·e professeur·e d’art m’avait dit qu’il était possible de faire une carrière dans l’art, ce que je ne savais pas avant. Je n’ai jamais remis en question ce choix. Le monde de l’art vient avec ses pressions, mais, en tant qu’artiste émergent, je me concentre sur mon évolution personnelle plutôt que sur le succès prématuré. Le succès, qu’est-ce que c’est, d’ailleurs ? Selon moi, il s’agit seulement d’avoir la paix et la sécurité pour continuer à faire de l’art. Ma foi me permet de garder la tête froide.
Et toi ? Comment définirais-tu le succès pour un·e artiste ?
Travailler avec des personnes réfugiées m’a aussi beaucoup aidé. Ça m’a insufflé de l’empathie et de la compassion envers les populations déplacées, en particulier celles forcées de quitter leur maison. En écoutant leurs histoires, je me suis rendu compte de la fragilité de la vie. Aujourd’hui, ce sont elles, demain, cela pourrait être moi. Partager des repas avec ces personnes m’a fait apprécier la façon dont la nourriture est porteuse de mémoire et à quel point la culture y est liée.
J’adore les chiens. Tu as des animaux de compagnie ?
Amicalement, Brogan
De : Sandra Knecht
À : Brogan Aaron Mwesigwa
Lundi 13 octobre, 15h19
Cher Brogan,
Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas parlé. J’espère que tu vas bien. Je serai ravie que tu puisses visiter la Suisse un jour.
Dans deux jours, je voyagerai vers Berlin avec mes deux petits chiens pour travailler pour l’avenir. Je n’aurai donc pas le temps de te répondre avant décembre.
Quoi qu’il en soit, je te souhaite tout de bon et beaucoup de succès dans tous tes projets.
Bien à toi ! Sandra
De : Brogan Aaron Mwesigwa
À : Sandra Knecht
Lundi 13 octobre, 17h49
Chère Sandra,
Je vais bien, merci. J’espère que toi aussi.
Je viendrai en Suisse un jour. Je suis ravi de te connaître et de voir ta pratique, et je te souhaite un bon voyage vers Berlin.
Bonjour à tes deux petits chiens. Je te souhaite tout le meilleur et beaucoup de succès aussi. Je suis impatient de voir la publication.
Cordialement, Brogan
Brogan Aaron Mwesigwa (UG) (1997, Jinja) est un peintre ougandais dont le travail étudie la vie en Afrique postcoloniale à travers l’expression figurative et la pratique participative. Il peint principalement à l’huile sur du papier recyclé. Il transforme ainsi des rebuts de papiers en des surfaces expressives portant les histoires de mémoire, d’identité, de transformation et de communauté. Il mêle dans ses compositions l’imagination à l’observation aigüe de la société pour créer des allégories calmes, mais profondes des expériences contemporaines.
Dans le projet participatif de Brogan Aaron Mwesigwa, Kumanyagana, ces sujets sont approfondis au sein de la sphère sociale. Il s’appuie sur les traditions ougandaises d’hospitalité et de partage de la nourriture et explore les rassemblements communautaires en tant que sujet et méthode.
Il a une licence en arts industriels et beaux-arts de l’université Makerere. Ses œuvres ont été exposées lors d’évènements comme le KLA ART ‘24, l’Art Salon 2021, l’East African Artist Connect 2021 (2ème édition), et à sa première exposition en solo en 2021. Il était demi-finaliste des prix Tilga Art Fund et Mukumbya Musoke Art Prize. Son travail a été mis en avant dans The Guardian.
@broganmwesigwa
Sandra Knecht (CH) (1968, Zurich) possède un Master en beaux-arts de l’université des Arts de Zurich (ZHdK). La cuisine est l’élément central de sa pratique artistique. Avec ses évènements et installations culinaires, elle a participé à diverses biennales et a exposé dans des musées d’arts en Suisse et à l’étranger, notamment au KBH, à la fondation culturelle de Bâle H. Geiger, au Basel Social Club, à la Biennale de Venise, à la Fondation Joan Miró Museum de Barcelone, au Musée Tinguely de Bâle, à la Kunsthaus de Zurich, au Kunstmuseum de Bâle, à la Kunsthaus Baselland, au FRAC Alsace, à l’Industrial Art Biennial en Croatie et au festival international du film de Locarno. Elle a reçu de nombreux prix, dont le Swiss Art Award 2022, la bourse Basel Work Grant en 2015 et 2023, le Werkbund Label Baden-Württemberg en 2016 et l’ADC Award en 2017.
https://www.sandraknecht.ch/
@chnaechtspaecht
[1] Apprendre à se connaître
[2] Une variété de banane populaire en Afrique de l’Est
[3] Un plat à base de pommes de terre en forme de pancake/crêpe
[4] Un ragoût fait de pâtes, pommes de terre, oignons, restes de viande, saucisse, crème et fromage
[5] Farine de maïs bouillie
[6] Un mélange d’épices suisse
[7] Un mélange d’épices est africain